Marcel PROUST: Du côté de chez Swann
Une phrase mythique: « Longtemps je me suis couché de bonne heure… » Une scène fondatrice : l’enfant insomniaque attendant le baiser de sa mère, dans la chambre de Combray. Ainsi commence Du côté de chez Swann, premier volet du cycle romanesque de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu: Combray, le plaisir de la lecture, le drame du coucher, les visites de Swann, les promenades du côté de Méséglise, du côté de Guermantes, la chambre de tante Léonie… surgis de la mémoire, les lieux du passé se refont jour à la conscience, avec leur contenu sensible. Et puis, ce seront, dans un nouveau retour en arrière, la rencontre de Swann et d’Odette, des années auparavant, dans une sorte de tour de chauffe de quelques uns des principaux protagonistes du cycle romanesque naissant: le clan des Verdurin, Charlus; et une dissection des mécanismes de la passion amoureuse, préfiguration des amours à venir du narrateur…
Il y a, je ne l’ignore pas, quelque coquetterie à dire publiquement non pas qu’on lit, mais qu’on relit Proust. Certains y trouveront une forme de snobisme, peut-être une pause, dont on peut rire à l’occasion. On n’échappe pas, même comme lecteur, à la satire sociale que Proust a su si délicieusement mettre en scène! Mais il se trouve que j’ai lu une première fois « La Recherche » entre 20 et 21 ans. Une lecture qui m’avait pris toute une année, intercalant bien sûr d’autres lectures. Privilège de l’âge, plus de 30 ans après, j’ai entrepris en septembre dernier, de me lancer dans cette relecture. Cela me prendra sans doute beaucoup plus de temps que la première fois. Pour preuve ce billet que je traîne à écrire depuis septembre passé, mais auquel j’ai fini par me pousser, après avoir dévoré au cours de ces dernier jour la première partie du volume suivant, A l’ombre des jeunes filles en fleurs.
Paul Ricoeur, dans Temps et récit, écrit, au détour de l’une des lumineuses analyses qu’il consacre successivement à Proust, à Thomas Mann et à Virginia Woolf que tout se passe comme si La Montagne magique avait été écrite par Thomas Mann de telle sorte qu’elle doive être lue 2 fois, l’expérience du temps y étant changée dès lors qu’on en a fait une première expérience et que, comme le narrateur, on sait où le roman mène son héros. Il en va sans doute ainsi aussi de cet autre grand roman de l’expérience du temps vécu qu’est A la Recherche du temps perdu. A fortiori quand on le lit une première fois à 20 ans lorsque, aspirant à entrer dans un monde qu’on entrevoit, mais dont on n’a pas l’expérience, on retrouve dans les désirs du héros une expression contemporaine de ses propres désirs (ce que j’ai pu moi aussi à cet âge rêver sur le simple nom de Venise!). A plus de 50, je me sens plus proche du narrateur, de celui qui raconte et fait resurgir, dans l’écriture, une existence qui peut-être n’a pas d’autre site que celui de l’écriture elle-même, je me sens plus attentif à la radicalité d’une façon nouvelle de raconter, à ce surgissement du moi dans l’épaisseur de la mémoire – cette mémoire involontaire qui gouverne l’oeuvre, et qui se manifeste de manière fulgurante dans l’épisode célèbre de la madeleine: trempant le petit gâteau dans une tasse de thé, le narrateur fait l’expérience d’un surgissement du passé si puissant qu’il en bouleverse le cours même de sa pensée, et de son écriture, de la façon de conduire un récit: la littérature comme art de restituer la vérité du temps vécu.
A ce titre, Du côté de chez Swann, le premier volume d’À la recherche du temps perdu, est tout sauf un simple prélude : l’œuvre en soi s’y trouve déjà, dense, stratifiée, fondatrice – c’est même une sorte de roman foisonnant, débordant, puisqu’on trouve dans Du côté de chez Swann pas moins de trois romans déjà en un, ce qui à la première lecture, je m’en souviens d’ailleurs, m’avait un peu dérouté: « Combray », « Un amour de Swann », « Noms de pays: le nom ».
Si l’on a pu dire avec raison de « Combray » qu’il était le roman de l’enfance, c’est au sens où il est celui des apprentissages et des initiations. Le récit d’enfance, tout en impressions sensorielles, tout en figures maternelles et domestiques (la mère, la grand-mère, tante Leonie, Françoise…) dessine les premiers contours du monde proustien avec ses paysages (le jardin de Combray, la chambre de tante Leonie, l’église du village et ses vitraux, les sources de la Divonne vers lesquelles on part en promenade sans jamais pousser jusque là, le château de Tansonville, les aubépines en fleur…), ses noms de lieux (Méséglise, Guermantes), ses aspirations (le projet de devenir écrivain, sous la double inspiration de George Sand et de Bergotte), ses fascinations (les Guermantes), ses visages (Swann), ses initiations (la scène de saphisme et de sadisme entre la fille de Vinteuil et son amie, le geste obscène que lui adresse Gilberte), ses révélations encore balbutiantes (à l’occasion d’une courte page écrite sur les clochers de Martinville, la découverte qui restera inexploitée jusqu’au Temps retrouvé que le plaisir de l’écriture décuple celui de l’observation).
Au cœur de Du côté de chez Swann, Marcel Proust insère un récit presque détaché du fil principal de la Recherche : « Un amour de Swann ». Récit à la troisième personne, « Un amour de Swann » relate la passion dévastatrice de Charles Swann pour Odette de Crécy, des années auparavant. Swann rencontre Odette chez les Verdurin, dans ce petit cercle bohème qui se veut en rupture avec l’aristocratie mais n’en reproduit que les codes inversés. Odette est jolie, un peu vulgaire, cultivée sans profondeur. Swann, d’abord peu attiré, finit par céder à une fascination lente, sourde, insidieuse. Et très vite, ce n’est plus Odette qu’il aime : c’est l’idée d’Odette, ou pire, l’image qu’il se construit d’elle. Radiographie d’une précision impitoyable de l’histoire d’un homme cultivé, mondain, raffiné… qui tombe amoureux d’une femme qui ne lui convient pas, une cocotte, une demi-mondaine, et de comment ce qui devait être un caprice érotique devient une obsession destructrice, ce second volet de Du côté de chez Swann, véritable roman dans le roman, n’est pas coupé cependant du reste de La Recherche. C’est une plongée dans la jalousie, l’aveuglement amoureux, les illusions du désir. Et l’annonce d’un thème central chez Proust: autrui (et en particulier ceux que nous aimons) nous reste fondamentalement inaccessible, s’il est vrai, comme il l’écrira dans La Prisonnière qu’ « On n’aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d’inaccessible, on n’aime que ce qu’on ne possède pas. » Odette, de son côté, reste un personnage à la fois vide et fascinant. On ne la connaît jamais vraiment. Est-elle manipulatrice ? Ou simplement incohérente, comme chacun dans une relation inégale ? Est-elle sincère par moments ? Peut-être. Ce flou est voulu. Elle n’est jamais qu’un reflet dans le miroir de la conscience de Swann. Préfiguration de ce que sera plus tard l’amour du narrateur pour Albertine, « Un amour de Swann » constitue ainsi à lui seul déjà un très grand livre sur les mécanismes de l’attachement, les intermittences du cœur, les débordements de la passion, raison pour laquelle il est parfois édité et lu séparément.
Brève coda, « Noms de pays: le nom » nous fait retrouver le narrateur, ses rêveries, ses envies de voyage, alors que la maladie lui interdit jusqu’à une sortie au théâtre. On trouve dans cette troisième partie de superbes pages – celles dont je gardais encore le souvenir vif de ma première lecture: des rêveries sur Balbec, Venise, et les horaires des trains qui y conduisent. C’est l’annonce d’un autre grand thème de La Recherche, la déception naissant de la confrontation du rêve et de la réalité et la méditation qui s’en suit sur l’art seul capable de réenchanter le réel. A travers la figure de Gilberte, la fille de Swann, le désir se mêle à la géographie imaginaire préfigurant la encore la suite de La Recherche, notamment À l’ombre des jeunes filles en fleurs, avec lequel cette troisième partie s’enchaîne.
Je sors donc enthousiasmé de cette relecture – enfin, je devrais dire cette troisième (ou quatrième) lecture, puisqu’avant mes 20 ans, j’avais déjà lu une première fois Du côté de chez Swann – c’était en classe de Première – mais pas poursuivi plus avant malgré mon enthousiasme, puis j’ai déjà relu bien des années plus tard le seul Un amour de Swann. Toutes ces lectures s’enchaînant et se tissant pour ainsi dire les unes aux autres – c’est un plaisir aussi quand on relit de se voir lire en même temps des années avant, de se lire lisant pour ainsi dire – j’avais hâte de poursuivre avec le second volume, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, jamais rouvert depuis plus de 30 ans. Mais cela est une autre histoire…
« Seuls, s’élevant du niveau de la plaine et comme perdus en rase campagne, montaient vers le ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois : venant se placer en face d’eux par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieuxvicq, les avait rejoints. Les minutes passaient, nous allions vite et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin devant nous, comme trois oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu’on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieuxvicq s’écarta, prit ses distances, et les clochers de Martinville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant que même à cette distance, sur leurs pentes, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d’eux, que je pensais au temps qu’il faudrait encore pour les atteindre quand, tout d’un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds; et ils s’étaient jetés si rudement au-devant d’elle, qu’on n’eut que le temps d’arrêter pour ne pas se heurter au porche. Nous poursuivîmes notre route; nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu de temps et le village après nous avoir accompagnés quelques secondes avait disparu, que restés seuls à l’horizon à nous regarder fuir, ses clochers et celui de Vieuxvicq agitaient encore en signe d’adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois l’un s’effaçait pour que les deux autres pussent nous apercevoir un instant encore; mais la route changea de direction, ils virèrent dans la lumière comme trois pivots d’or et disparurent à mes yeux. Mais, un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin qui n’étaient plus que comme trois fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux trois jeunes filles d’une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l’obscurité; et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin et après quelques gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l’un derrière l’autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu’une seule forme noire, charmante et résignée, et s’effacer dans la nuit »
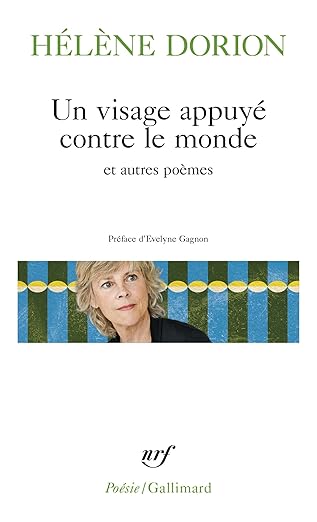
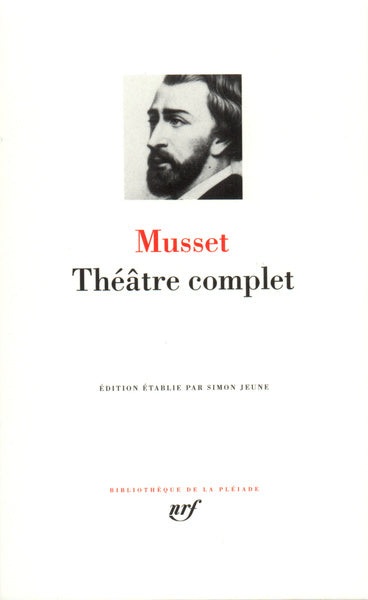
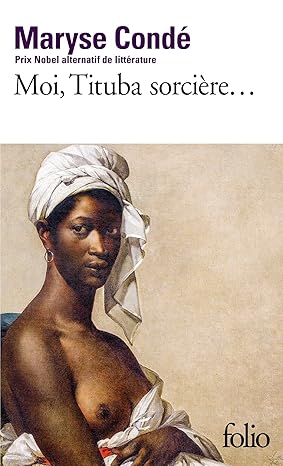
2 commentaires
keisha · 17 avril 2025 à 13 h 12 min
Ah je me doutais bien que c’était une relecture! ^_^ Personnellement je me suis lancée vers 30 ans, et heu, oui, j’en suis à plusieurs lectures, actuellement je piétine dans La prisonnière… (courage!)
Cléanthe · 17 avril 2025 à 21 h 05 min
J’ai quasiment tout oublié de ce volume, sinon l’ouverture (le narrateur, au lit, et les bruits de Paris) et le climat de jalousie bien pesant. Le thème de la jalousie n’est pas ce que je préfère chez Proust, quoique j’ai relu avec beaucoup de plaisir Un amour de Swann qui m’avait semblé bien long à la première lecture.