Philip ROTH: Pastorale américaine
1968. Ancien athlète charismatique, héritier d’une prospère entreprise familiale de gants, Seymour Levov, dit « le Suédois », a tout d’un homme heureux: une carrière florissante, une belle épouse ex-reine de beauté, une maison dans la campagne cossue du New-Jersey, une famille parfaite, la promesse d’un avenir radieux. Originaire d’Europe centrale, sa famille – des juifs polonais qui ont émigré dans le plus grand dénuement aux Etats-Unis – a su en trois générations s’intégrer à ce Nouveau monde et a atteint, à force de travail, une réelle prospérité et une position sociale respectée. Une vie apparemment idéale. L’incarnation du rêve américain! Mais derrière cette image idyllique se cache une tragédie: Merry, la fille adorée du « Suédois », bascule dans l’extrémisme politique et commet un attentat qui détruit non seulement une vie innocente, mais aussi tout ce en quoi son père croyait. À travers la quête bouleversante d’un homme cherchant à comprendre la faillite de son propre rêve, Roth, par la voix de Zuckerman, le narrateur de ce roman, dissèque les illusions du rêve américain et expose une Amérique déchirée par ses contradictions…
Il y a des écrivains précoces, ce que fut Philip Roth, auteur d’un succès planétaire, son troisième roman, publié en 1969, Portnoy et son complexe: les confessions d’un obsédé sexuel juif américain à son psychanalyste – un chef d’oeuvre d’humour décapant! Il y a aussi des maturités fructueuses. Parvenu à la soixantaine, Philip Roth signe, à la toute fin des années 1990, une trilogie majeure, la « Trilogie américaine ». En trois romans puissants, intenses, inoubliables, il explore les illusions et désillusions du rêve américain: Pastorale américaine (1997), J’ai épousé un communiste (1998), La Tache (2000). Ces romans, indépendants mais thématiquement liés, brossent un portrait des États-Unis de la seconde moitié du XXe siècle, exposant les conflits politiques, sociaux et identitaires qui ont marqué le pays. Pastorale américaine suit la descente aux enfers de Seymour Levov, dont la vie parfaite s’effondre lorsque sa fille commet un attentat politique dans le contexte des mouvements de contestation de la guerre du Vietnam. J’ai épousé un communiste explore à travers la figure d’Ira Ringold, acteur et militant communiste pris dans la tourmente du maccarthysme, la paranoïa politique des années 1950. Dans La Tache, à travers le destin de Coleman Silk, un professeur respecté, qui voit sa carrière ruinée par une accusation de racisme, Roth aborde les thèmes du politiquement correct, de l’identité et du poids du passé dans une Amérique obsédée par l’affaire Monica Lewinsky.
Je dois dire que le premier de ces trois romans m’est apparu comme un authentique chef-d’oeuvre, aussi bien par sa construction narrative que par la déconstruction du mythe du rêve américain à laquelle il procède, à travers le surgissement du chaos, traité comme un leitmotiv, qui explose régulièrement dans des images d’une maîtrise époustouflante. C’est aussi un grand roman naturaliste qui sait trouver les mots pour dire les transformations de la ville (en l’occurrence ici Newark), les ruines d’un monde industriel, les beautés du travail, la fierté qu’il procure. Dans ce roman, Seymour Levov pourrait incarner la réussite parfaite. Cependant, son monde s’écroule lorsque sa fille, Merry, s’engage dans la lutte radicale contre la guerre du Vietnam et pose une bombe dans un bureau de poste, tuant un innocent. Cette tragédie le plonge dans une quête désespérée pour comprendre ce qui a mal tourné, alors qu’il voit son rêve s’effriter sous ses yeux. Faire tenir près de 600 pages sur cet effritement était une gageure. Un tour de force que Philip Roth réussit magistralement.
Le roman commence sur une longue évocation de l’adolescence du narrateur, Nathan Zuckerman, double fictif de l’écrivain, à Newark, banlieue industrielle de New-York, où Philip Roth a grandi, dans le quartier de Weequahic, quartier d’accueil historique de la communauté juive. C’est une évocation sensible d’où surgit le personnage de Seymour Levov, que l’on appelait « le suédois », à cause de sa chevelure blonde et son physique de gaillard bien bâti, une figure emblématique de l’adolescence de Zuckerman. Le Suédois était une légende locale, admiré pour son charisme et ses succès sportifs. Parvenu à la soixantaine, Zuckerman rencontre par hasard le Suédois qui l’invite pour lui demander des conseils sur un livre qu’il veut écrire sur le destin de sa famille. Rencontre manquée! Seymour, lui raconte brièvement sa vie, mais sans entrer dans les détails. Peu de temps après, Zuckerman qui assiste à une réunion d’anciens élèves où il retrouve Jerry, le frère de Seymour, apprend sa mort et que ce dernier a connu une vie bien plus tragique qu’il n’imaginait. Et là, entre grivoiseries des uns et élans de retrouvailles, serré dans un mouvement de danse contre une ancienne camarade de lycée, qui lui avait interdit de toucher ses seins un jour qu’ils étaient sortis ensemble dans leur adolescence, Zuckerman se saisit de l’histoire du Suédois et reconstitue ce qu’aura pu être son parcours. Réalité ou fantasme? Reconstruction d’un écrivain parvenu au soir de sa vie et tiraillé par ses problèmes de prostate, ou grande épopée tragique de l’Amérique contemporaine? Tout le roman de Roth, habile à jouer des limites de la fiction et du réel, tient dans cette ambiguïté d’un récit qui naissant, comme La Recherche de Proust, finit par prendre voix comme les magnifiques machines narratives de Joseph Conrad, Lord Jim, Nostromo ou Au coeur des ténèbres. Entre le Narrateur et Charles Marlow.
S’il fallait en résumer brièvement le propos (ce à quoi ce billet, long exercice d’admiration d’un livre adoré, a renoncé!) je dirais que le roman raconte la longue quête d’un père qui recherche sa fille disparue après l’attentat qu’elle a commis. Cette quête est double: Seymour qui ne retrouve plus son enfant dans celle qui a perpétré cet acte, la cherche aussi physiquement, alors que la jeune fille a fui dans la clandestinité. La quête d’une fille, d’un rêve, d’un passé devenus inaccessibles!
En même temps, Seymour tente désespérément – mais en vain – de comprendre les raisons profondes de cet acte, qui bouleverse non seulement sa famille – avec des répercussions sur sa femme et ses parents – mais aussi son propre système de valeurs. Ce rêve américain qu’il chérissait se révèle n’être qu’une façade fragile, derrière laquelle se cache un chaos fondamental. Le Suédois Roth semblait avoir tout pour être heureux, il incarnait la promesse d’ascension sociale et de prospérité de la société américaine. Mais la réussite du Suédois est une illusion: la violence politique et les tensions sociales des années 1960 viennent briser ses espoirs d’une vie harmonieuse. Obligé de plonger dans l’envers du décor, il découvre un monde où règnent le désordre et le chaos, un motif que Roth développe à travers des descriptions sublimes de terrains vagues, de viaducs à l’abandon, de scènes des émeutes raciales. Tandis que Merry rejette tout ce que représente son père, le Suédois ne peut saisir la révolte de sa fille: un échec parental et social plus large, où l’héritage des valeurs traditionnelles ne parvient pas à résister aux bouleversements de l’époque. Toute une Amérique est en outre évoquée en toile de fond : la presse, les matchs de base-ball, les concours de beauté, les barbecues, la vogue de la chirurgie esthétique, autant d’éléments qui composent l’univers d’un rêve américain en pleine remise en question. Pastorale américaine s’inscrit ainsi dans une veine tragique, où l’hubris du protagoniste – sa croyance en un monde rationnel et ordonné – est mise à mal par une réalité chaotique et imprévisible. Roth met en lumière la fragilité des certitudes, la brutalité d’un monde où le contrôle absolu est impossible. L’effondrement du Suédois est non seulement personnel et familial, mais aussi moral et culturel.
Dans une interview que j’ai lue une fois le roman refermé, Philip Roth évoque la réalité du rêve américain et le personnage de son héros, Seymour Levov, un industriel d’origine juive polonaise bien intégré dans la société américaine. Il revient sur la brusque entrée de l’Histoire dans la vie de Seymour à travers l’acte terroriste commis par sa fille, et explique pourquoi il a choisi une fille comme terroriste impliquée dans des meurtres. Il s’inspire notamment de Kathy Budding, une militante gauchiste des années 1965-74, entrée dans la clandestinité après un attentat et arrêtée dans les années 80 pour un hold-up meurtrier. Roth souligne également comment la guerre du Vietnam a mis à l’épreuve l’allégeance des Américains à leur pays et comment la réaction de la jeunesse face à cette guerre a contribué à sa fin.
Si son oeuvre se nourrit de l’Histoire et de ses tensions, il ne faudrait pas oublier qu’il y a aussi chez Roth un grand romancier élégiaque. La nostalgie d’un monde disparu qui s’affirme à travers un récit raconté par un écrivain, Nathan Zuckerman, double littéraire de Roth, est aussi celle d’un monde dominé par le travail artisanal et ses valeurs. On conçoit qu’un écrivain comme Roth soit fasciné par l’artisanat, le monde de la fabrication. Il insuffle ainsi dans Pastorale américaine une dimension lyrique à la description du travail, qui est peut-être l’antidote à cette tragédie, notamment à travers les belles évocations du travail de la fabrication des gants dans l’usine dont le Suédois a hérité la direction de son père. Ce monde de la fabrique, de l’ouvrier attaché durant sa vie à un travail qui ne l’aliène pas seulement, mais qui fait sa fierté – tanner les peaux, couper les gants, coudre les pièces – a aussi ses seigneurs, ses artistes de la main d’oeuvre, ses aristocrates du travail. Un monde perdu dont ne restent que les ruines d’usines dans le paysage violent et disloqué de Newark, arrachée au rêve de porte de l’Amérique, pour toute une population de travailleurs venus chercher aux Etats-Unis une vie plus heureuse et plus libre.
On lutte contre sa propre superficialité, son manque de profondeur, pour essayer d’arriver devant autrui sans attente irréaliste, sans cargaison de préjugés, d’espoirs, d’arrogance; on ne veut pas faire le tank, on laisse son canon, ses mitrailleuses et son blindage; on arrive devant autrui sans le menacer, on marche pieds nus sur ses dix orteils au lieu d’écraser la pelouse sous ses chenilles; on arrive l’esprit ouvert, pour l’aborder d’égal à égal, d’homme à homme comme on disait jadis. Et, avec tout ça, on se trompe à tous les coups. Comme si on n’avait pas plus de cervelle qu’un tank. On se trompe avant même avant même de rencontrer les gens, quand on imagine la rencontre avec eux; on se trompe quand on est avec eux; et puis quand on rentre chez soi, et qu’on raconte la rencontre à quelqu’un d’autre, on se trompe de nouveau. Or, comme la réciproque est généralement vraie, personne n’y voit que du feu, ce n’est qu’illusion, malentendu qui confine à la farce. Pourtant, comment s’y prendre dans cette affaire si importante- les autres- qui se vide de toute la signification que nous lui supposons et sombre dans le ridicule, tant nous sommes mal équipés pour nous représenter le fonctionnement intérieur d’autrui et ses mobiles cachés? Est-ce qu’il faut pour autant que chacun s’en aille de son côté ,s’enferme dans sa tour d’ivoire , isolée de tout bruit, comme les écrivains solitaires, et fasse naître les gens à partir de mots, pour postuler ensuite que ces êtres de mots sont plus vrais que les vrais, que nous massacrons tous les jours par notre ignorance? Le fait est que comprendre les autres n’est pas la règle, dans la vie. L’histoire de la vie, c’est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau. C’est même comme ça qu’on sait qu’on est vivant: on se trompe. Peut être que le mieux serait de renoncer à avoir tort ou raison sur autrui, et continuer, rien que pour la balade. Mais si vous y arrivez, vous..alors vous avez de la chance.
Philip Roth, Pastorale américaine (1997), traduction: Josée Kamoun, Folio/Gallimard
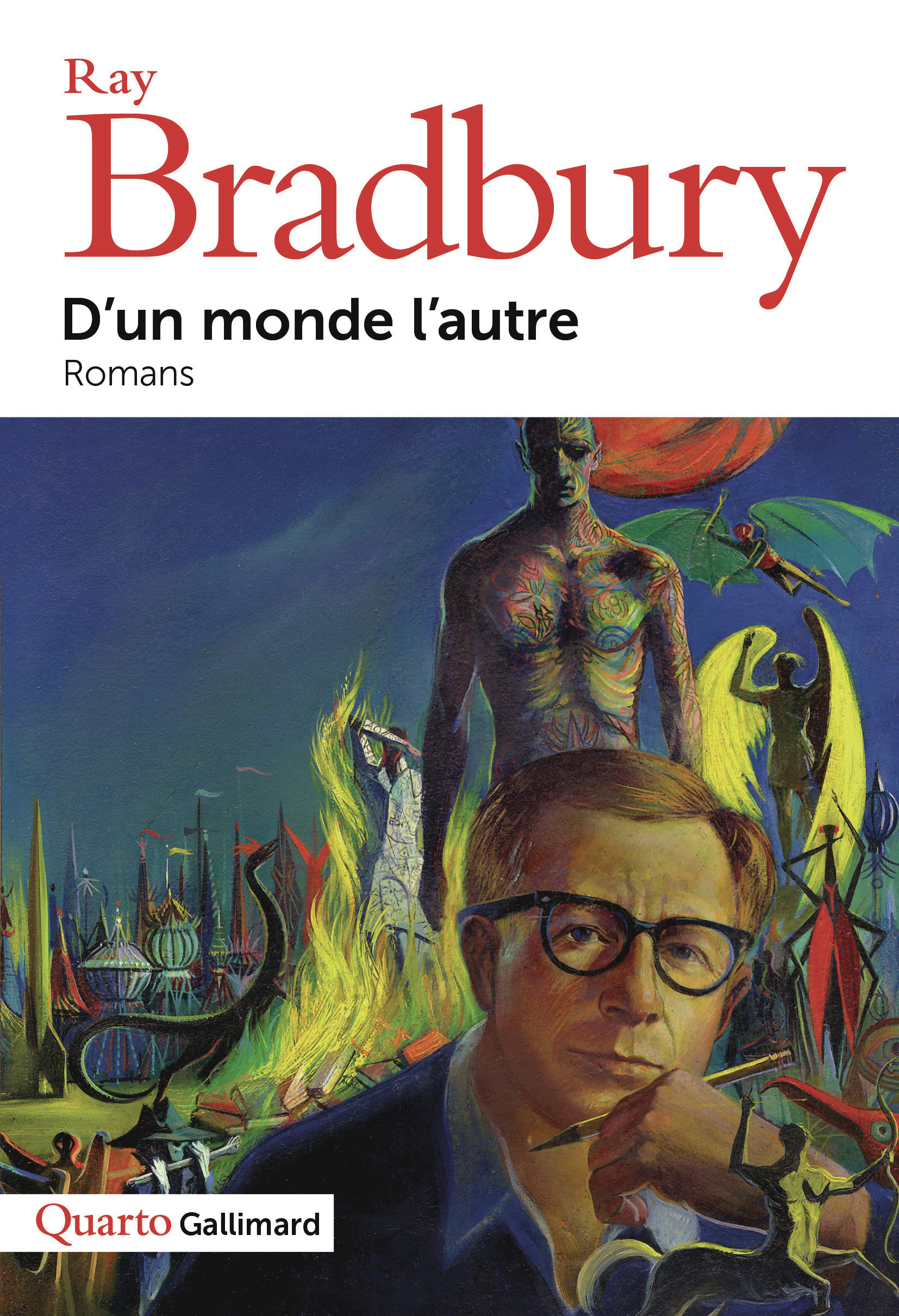
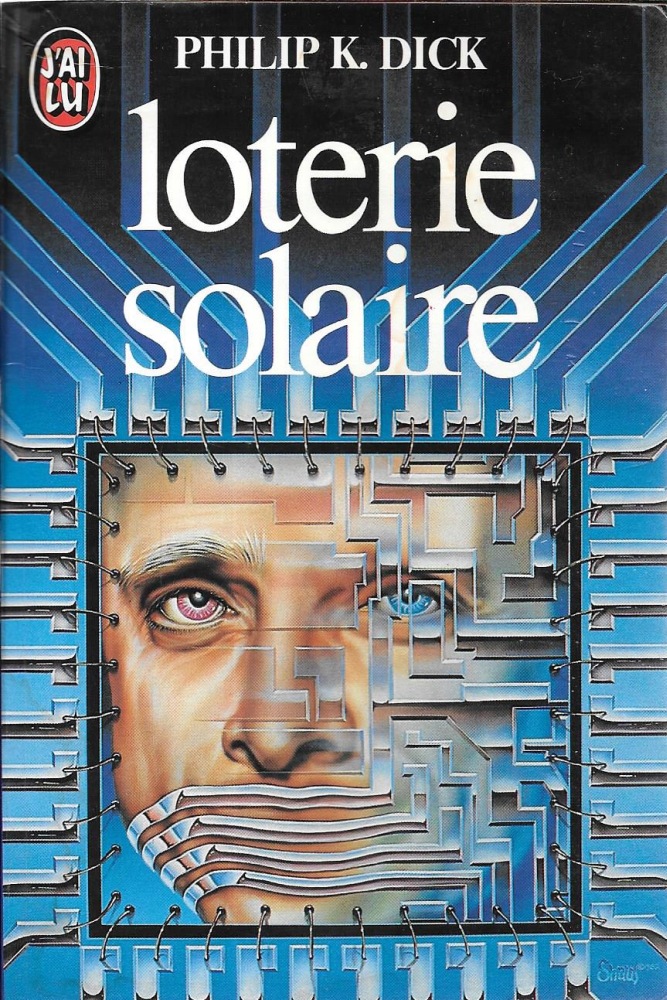
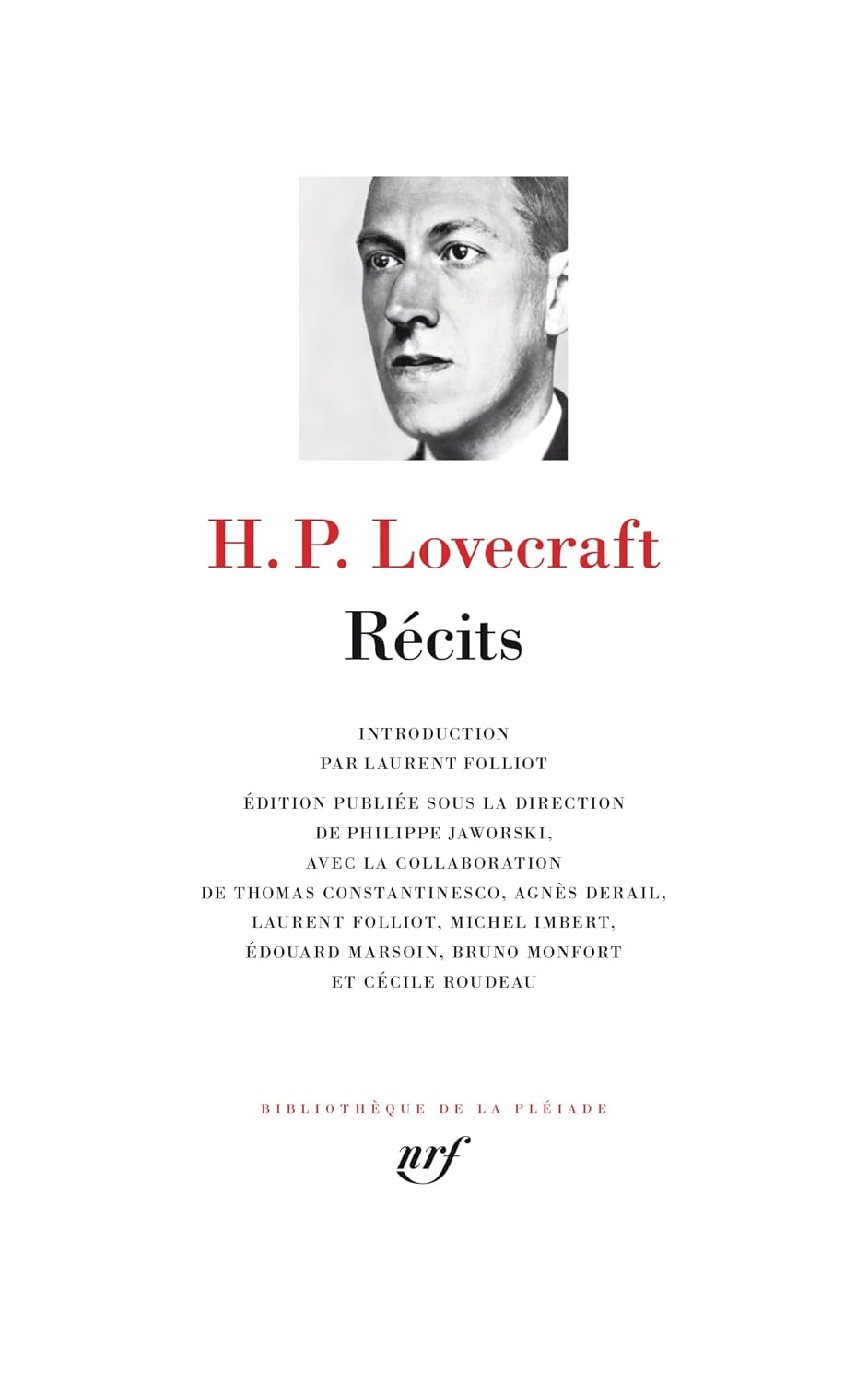
12 commentaires
Sandrine · 22 février 2025 à 7 h 02 min
Un bien beau billet qui me rappelle que je n’ai pas beaucoup lu Philip Roth… j’ai tort.
(j’ai beau cocher la case « Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire. », il faut que je les retape à chaque fois…
Cléanthe · 22 février 2025 à 18 h 58 min
C’est ce que je me suis dit aussi. Du coup je me suis lancé dans cette « Trilogie americaine »
Pour l’enregistrement des données, je vais voir si je trouve une solution, mais je ne garantis rien…
Ingannmic · 22 février 2025 à 12 h 13 min
Je rejoins Sandrine, quel beau billet ! Et je TE rejoins sur le fait que nous avons là un chef d’oeuvre… c’est celui que j’ai préféré de la trilogie, mais il faudrait que je relise La tâche, que je crois n’avoir pas apprécié à sa juste valeur pour l’avoir mal compris.
Cléanthe · 22 février 2025 à 19 h 02 min
Je vais te dire bientôt ce que je pense de « La Tache ». Je me suis lancé dans les trois volumes de la trilogie, dont j’entrecoupe la lecture de quelques autres titres, histoire de retrouver un regard neuf. Mais le 2e billet ne devrait pas trop tarder à suivre.
Dominique · 23 février 2025 à 11 h 41 min
un livre qui comme pour toi m’a semblé un chef d’oeuvre, je l’ai relu depuis sa parution et mon avis n’a pas changé
si tu n’a pas lu La Tâche précipites toi c’est magnifique aussi
Cléanthe · 23 février 2025 à 16 h 25 min
« La Tache » est prévue pour bientôt. J’ai un Kawabata à finir (oui, il fallait reprendre quelques respirations sur le chemin de cette Trilogie américaine) et je commence « J’ai épousé un communiste ».
Virginie Vertigo · 24 février 2025 à 17 h 16 min
En 2020, alors que je n’avais lu jusqu’à alors que deux Philip Roth, j’ai eu une boulimie de lecture. En une année et quelques étés suivants, j’ai dû lire les 2/3 voire 3/4 de sa bibliographie.
Pastorale américaine est vraiment un très très grand roman tout comme La tâche. Ce sont des oeuvres majeurs, des bijoux.
Je suis amoureuse de Philip Roth et ça me fait penser que j’ai Opération Shylock qui m’attend dans la bibliothèque.
Cléanthe · 24 février 2025 à 17 h 45 min
Oui, j’attends beaucoup de la Tache – lecture qui ne saurait trop tarder d’ailleurs.
Dominique · 25 février 2025 à 11 h 53 min
j’ai beaucoup aimé la trilogie et j’ai épousé un communiste ramène au temps funeste du MacCarthysme et fait penser au destin de Donald Trumbo
le roman est excellent mais un peu en dessous des deux autres
Cléanthe · 25 février 2025 à 15 h 09 min
J’ai l’impression en effet qu’il est un peu au-dessous. Mais je ne suis qu’au début. En tout cas, ce climat de suspicion généralisée, et la brutalité qui va avec, me fait penser aussi au moment contemporain que traversent les Usa.
Violette · 1 mars 2025 à 17 h 42 min
Je crois que je n’ai lu qu’Exit le fantôme, mais tu donnes sacrément envie de revenir vers lui !!
Cléanthe · 5 mars 2025 à 7 h 49 min
Si tu y reviens, n’hésite pas à faire signe: on pourrait peut-être prévoir une LC autour d’une de ses œuvres.