Edith WHARTON: Leurs enfants
Pendant des années, Martin Boyne, un ingénieur célibataire d’une quarantaine d’années, a parcouru le monde, au gré de différents chantiers. Apprenant le décès du mari de Rose Sellars, qu’il aime secrètement depuis toutes ces années, laquelle ne semble pas avoir été jusque là insensible à ses manifestations d’amitié, Martin embarque depuis Alger, en direction de Venise, afin de rejoindre Rose qui passe quelques mois de villégiature dans les Alpes italiennes, dans les Dolomites. Sur le navire, un troupe de jeunes enfants, turbulents et charmants, attire rapidement son regard. Les enfants sont accompagnés par leur grande soeur, une toute jeune fille, dont Martin a jadis connu les parents, femme-enfant chez qui commence à poindre cependant les charmes d’une maturité précoce…
Le roman d’Edith Wharton, Leurs enfants, est l’occasion pour moi de parler d’une petite collection qui fait un travail remarquable, et dans laquelle j’ai découvert, ou redécouvert de nombreux auteurs. La Petite bibliothèque Ombres offre en effet de belles découvertes de lecture: pour la plupart des rééditions de classiques souvent oubliés, qui font en plus de beaux objets, sous leur couverture bleue, que j’aime à collectionner. Bien sûr, les quelques volumes consacrés à Edith Wharton (deux romans et deux recueils de nouvelles) ont rapidement rejoint ma bibliothèque! Des volumes d’autant plus précieux qu’ils ne sont pas la partie la plus connue de l’écrivaine américaine.
On connaît en effet le plus souvent la chronique mi-nostalgique, mi-satirique qu’Edith Wharton a produite du Vieux New-York du Gilded Age dans des romans restés célèbres (et leur adaptation au cinéma): Chez les heureux du monde, Le Temps de l’innocence (si vous ne connaissez pas encore, foncez, ce sont de très grands et bons romans!) – des romans qui ont fait l’objet d’un récent volume chez Gallimard dont j’aurai à reparler sous peu. Avec Leurs enfants, on aborde une période moins connue de l’œuvre de la romancière.
Plongeon ici dans les Années folles! En Europe, parmi une population cosmopolite de personnalités autant égoïstes que fortunées, donnant lieu à une satire caustique et désopilante sous la plume d’une Edith Wharton décidément bien inspirée. Excentricités, absence de morale, frivolité – autant de motifs qui, entre des régates au Lido et des cocktails sur le Grand Canal, livrent le portrait sans concession d’une génération qui s’étourdit de fêtes et n’a guère de considération pour les enfants, traînés d’hôtels luxueux en hôtels luxueux, où ils s’élèvent comme des petits sauvages. Il y a du Henry James dans ce portrait d’une enfance sacrifiée à l’égoïsme des adultes. Et cela ne doit pas nous étonner, quand on connait l’admiration qu’Edith Wharton vouait à son mentor en littérature et ami, auquel elle confia avant publication les manuscrits de chacun de ses livres, jusqu’à la mort du grand écrivain, en 1916. Certes, Leurs enfants est bien éloigné des prouesses et autres expérimentations modernistes du génial Ce que savait Maisie de James. Mais une certaine communauté de ton ne peut pas ne pas frapper ici. Même si Wharton fait du Wharton comme toujours. Et j’en donnerai deux exemples pour poursuivre ce billet.
La petite colonie infantile, composée au hasard des mariages, remariages et reremariages de leurs parents, qui cherche un peu de stabilité auprès de Martin Boyne rencontré par hasard sur le bateau qui les conduit depuis Alger est une de ces trouvailles épatantes dont Wharton a le secret (je pense à tous ces personnages hors normes qui peuplent ses romans, parmi lesquels tout particulièrement l’imposante Mrs Manson Mingott du Temps de l’innocence). D’autant que les enfants ne font ici l’objet d’aucune idéalisation: mal élevés, turbulents, mais pour autant attachants, après avoir tenté de convaincre Martin à leur cause afin qu’il plaide auprès de leurs parents de ne pas être une fois de plus séparés, ils finissent par fuir tous ensembles, accompagnés de leur grande soeur et de leur gouvernante, et par débarquer à Cortina d’Ampezzo où Martin a rejoint Rose Sellars, avec laquelle il partage baisers et projets d’avenir tout en profitant des charmes de la montagne en été.
L’autre trouvaille caractéristique de l’art d’Edith Wharton, qui se retrouve de roman en roman avec des variations qui chaque fois en renouvellent la forme, est le motif du triangle amoureux: un homme, ici Martin, partagé entre deux femmes, qui sont comme deux destinées, des destinées qui le séduisent peut-être moins pour ce que ces femmes sont que pour ce qu’elles représentent, pour ce qu’il en fantasme: la concrétisation du bonheur rêvé au cours de nombreuses années; la quête de l’éternelle jeunesse qui s’éloigne pour cet homme entré dans la quarantaine. L’idylle alpine de Martin et de Rose, dans la petite maison que celle-ci a aménagée avec raffinement au-dessus de Cortina d’Ampezzo où Martin vient chaque jour la rejoindre, période de délices délicats qui finit mal bien sûr après avoir tant promis, est un des beaux passages du roman. Judith, à la fois encore enfant et déjà précocément femme sous le poids des responsabilités qui sont les siennes, dont le lecteur comprend bien avant Martin le type de charme ambigue, et dérangeant (le jeune fille n’a que 15 ans), que celle-ci exerce sur lui, est un très beau personnage de roman. Rien de scabreux là dedans. Simplement un homme, comme on en trouve beaucoup chez Edith Wharton, incapable de faire le tri entre ses émotions, vélléitaire. Loin de ces personnages féminins, qui assument leur destin.
Des années plus tard, Rose a rejoint les Etats-Unis. Judith est une jeune femme qui aborde sa vie d’adulte. Dans une belle scène où, de retour en Europe pour quelques semaines de convalescence, à la suite d’une longue période passée en Amérique du sud, Boyne observe, à travers les fenêtres de la salle de bal d’un hôtel de luxe, Judith croisée là par hasard, sans oser aller vers elle ni signaler sa présence, la solitude amère à laquelle sont condamnés bien des héros des romans d’Edith Wharton finit d’éclairer le destin d’un personnage qui aura plus rêvé sa vie qu’il ne l’aura vécue.
« Il buvait sa présence d’un regard passionné. Elle portait une robe de soie couleur d’oeillet, de ce rose qui se moire d’argent comme le duvet du brugnon. La riche étoffe ruisselait en un double étage de volants sur lesquels les deux mains de la jeune fille immobile semblait flotter comme deux mouettes à la crête des bagues brillantes. Au lieu de se couper les cheveux sur la nuque, elle les avait laissés pousser et les battait en forme de huit et pour les retenir y avait piqué un vieux bijou qui imitait une flèche de brillants. Elle avait la gorge et les bras découverts; mais un bracelet de velous noir relevait la tendre harmonie rose et or de sa toilette et de son teint. Boyne lui trouva les yeux agrandis et le regard plus lointain. Mais la bouche était charnue et rouge comme toutes les fois qu’elle se sentait heureuse. Un des jeunes gens se pencha pour lui dire quelque chose. Elle écouta en cachant ses lèvres sous un grand événtail noir et en abaissant les paupières une seconde comme elle faisait quand elle voulait garder un sevret. Mais elle referma l’éventail; sa physionomie avait déjà changé; elle avait la mélancolie d’un crépuscule d’automne. »
Edith Wharton, Le Temps de l’innocence (1928), chap.XXXII, traduction Louis Gillet, revue et corrigée par Sylvie Rozenker, Editions Ombres, Petite bibliothèque Ombres, p.309
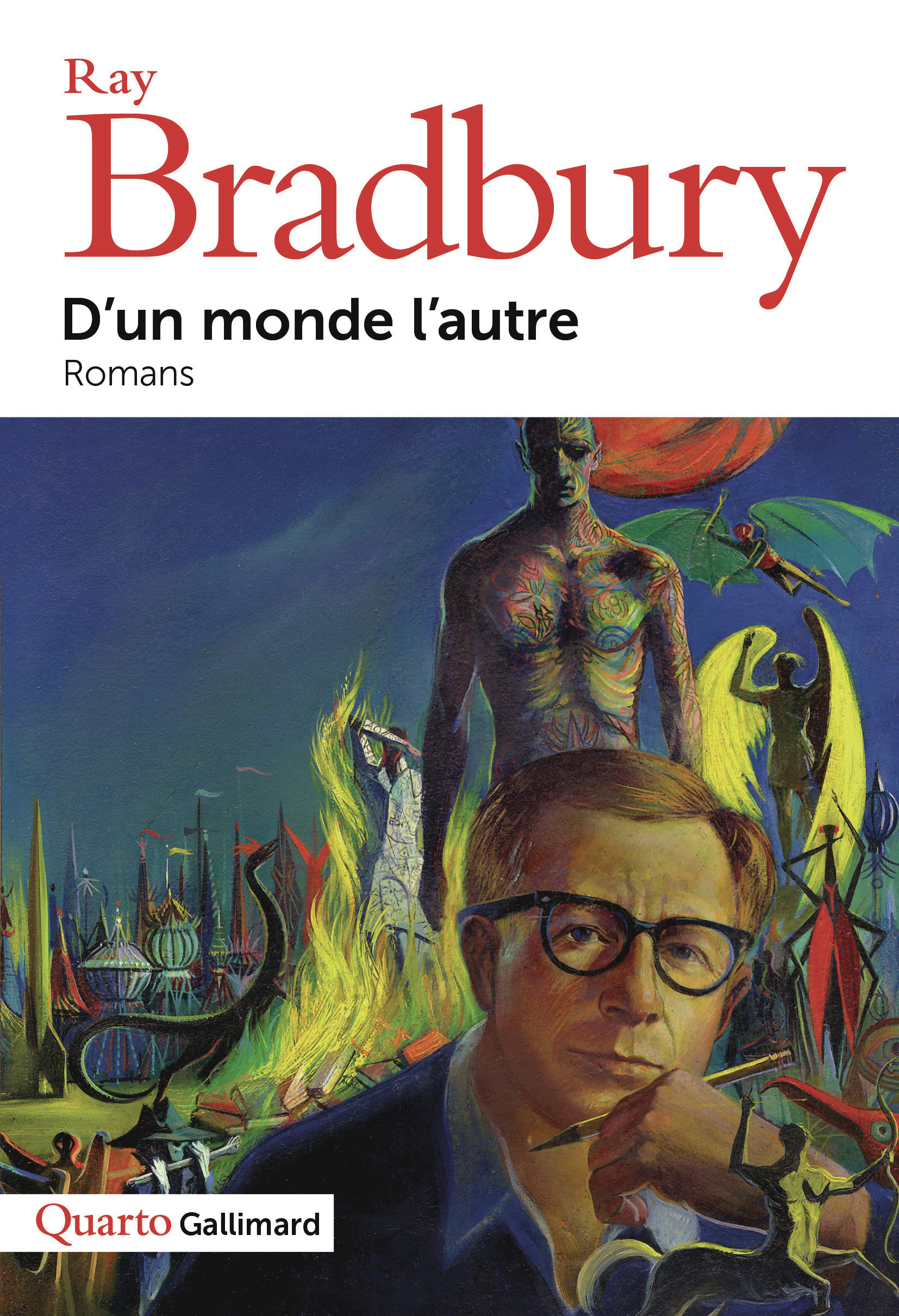
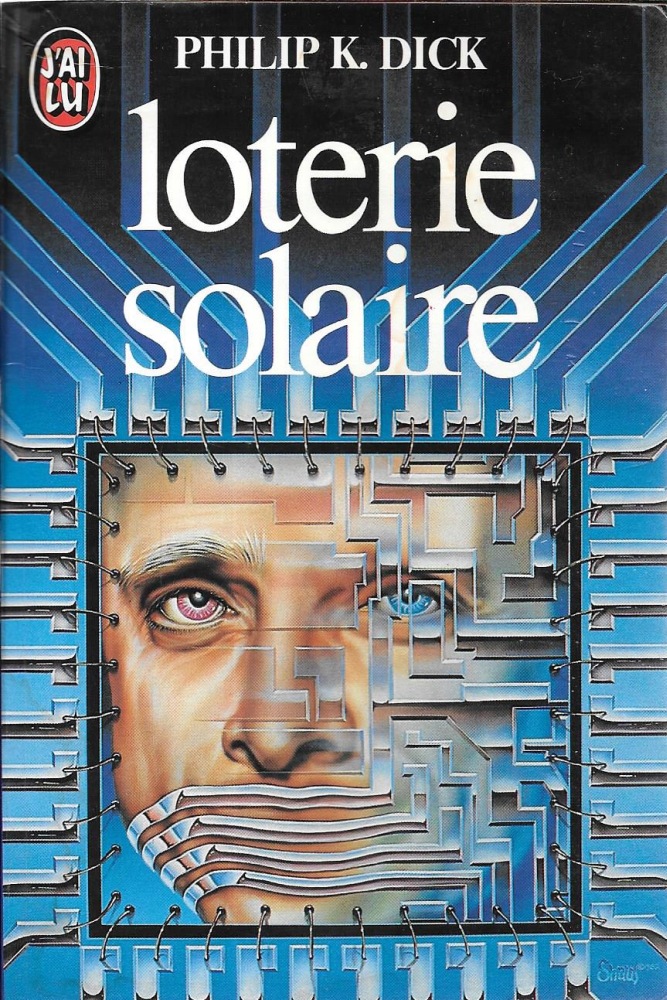
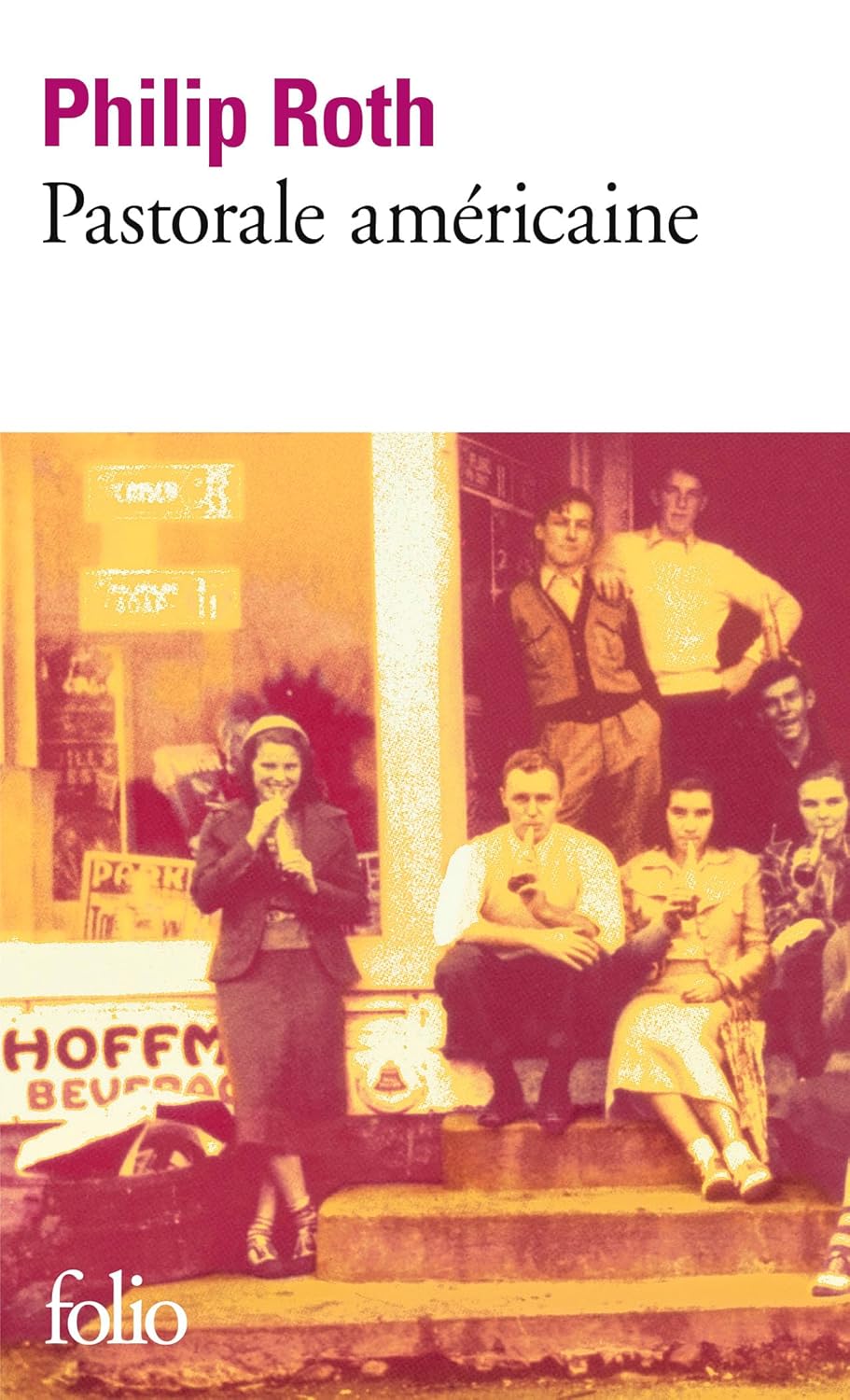
4 commentaires
Aifelle · 12 février 2025 à 8 h 49 min
J’ai lu plusieurs romans d’Edith Wharton, dont « le temps de l’innocence ». Par contre je suis à peu près sûre de ne pas avoir lu « Leurs enfants ». Ce qui pourrait me faire découvrir en même temps une collection que je ne connais pas.
Cléanthe · 12 février 2025 à 14 h 08 min
C’est un roman moins connu, mais qui vaut vraiment le détour.
Violette · 13 février 2025 à 11 h 00 min
Je ne l’ai jamais lue, cette autrice… pourquoi pas.
Cléanthe · 13 février 2025 à 13 h 13 min
C’est une autrice épatante que je te conseille vivement.