Maryse CONDÉ: Le Cœur à rire et à pleurer
« Si quelqu’un avait demandé à mes parents leur opinion sur le Deuxième Guerre mondiale, ils auraient répondu sans hésiter que c’était la période la plus sombre qu’ils aient jamais connue. Non pas à cause de la France coupée en deux, des camps de Drancy ou d’Auschwitz, de l’extermination de six millions de Juifs, ni de tous ces crimes contre l’humanité qui n’ont pas fini d’être payés, mais parce que pendant sept interminables années, ils avaient été privés de ce qui comptait le plus pour eux: leurs voyages en France. Comme mon père était un ancien fonctionnaire et ma mère en exercice, ils bénéficiaient régulièrement d’un congé « en métropole » avec leurs enfants. Pour eux, la France n’était nullement le siège du pouvoir colonial. C’était véritablement la mère Patrie et Paris, la Ville lumière qui seule donnait de l’éclat à leur existence. »
Parcourue en librairie, la première page de ces Contes vrais de mon enfance, comme Maryse Condé sous-titre le premier volume de ses Mémoires, a suffi à me faire repartir avec le livre sous le bras, que j’ai lu d’un trait en l’espace d’une journée. Il y a pour cela des raisons personnelles. Le nom de Maryse Condé était depuis longtemps sur mes listes, vers quoi me portait l’origine d’un grand-père antillais. Martiniquais, comme à une autre époque, on aurait été breton ou auvergnat. Cela m’a toujours un peu surpris. Et je me souviens de la dernière conversation que j’ai eu avec ma grand-tante, la sœur de ce grand-père – elle résidait en Guadeloupe, mais elle se rendait régulièrement en métropole. Je sortais à peine de l’adolescence. C’était encore au 20e siècle. Nous avions parlé de la Caraïbe, de son jardinier qui militait pour l’indépendance, et d’Aimé Césaire. Ses réactions m’étonnaient, surtout quand nous avons parlé d’Aimé Césaire. J’ai trouvé dans le livre de Maryse Condé des réponses aux questions qui s’étaient levées ce jour-là, sans que je ne les formule jamais précisément. Je pense que la famille de mon grand-père appartenait à peu près au même milieu que celle de Maryse Condé. J’ai pu grâce à elle mettre des mots sur cet horizon caribéen.
Benjamine d’une famille de huit enfants, une famille de « Grands nègres », comme elle les nomme, des guadeloupéens noirs accédant à la bourgeoisie et fiers d’être français, Maryse Condé, disparue récemment, est sans aucun doute l’une des écrivaines majeures du début de ce siècle et de la fin du siècle précédent. Son père, Auguste Boucolon, est l’un des fondateurs de la Banque Antillaise. Sa mère, Jeanne Quidal, fut la première institutrice noire de Guadeloupe. Ses parents parlent le français à la maison. Le créole y est interdit. Ils commandent des livres de littérature française à la librairie Nelson. Et ils se rendent régulièrement à Paris, comme le faisaient les bourgeois de province du début et du milieu du 20e siècle. A cette époque, dans le milieu familial de Maryse Condé, la Guadeloupe n’est en effet qu’une des nombreuses figures de la Province, une province française d’outre-mer avec ses particularismes régionaux. A Pointe-à-Pitre, ils habitent « une rue digne, habitée par des notables », comme on en trouve dans toutes les villes de Préfecture et de Sous-Préfecture. Auguste, qui vient d’être décoré de la Légion d’honneur, porte fièrement ses rubans sur chacune de ses boutonnières. Ils se sentent un peu supérieurs. En gros, des notables, dans la France du 20e siècle, pour qui la bourgeoisie n’est pas un milieu, mais une promotion sociale, hantés qu’on ne les confonde avec des personnes ordinaires.
A Paris, ils s’indignent, à la terrasse d’un café, de la remarque d’un serveur, qui croit être aimable en leur disant qu’ils parlent vraiment bien le français:
« Mes parents recevaient le compliment sans broncher ni sourire et se bornaient à hocher du chef. Une fois que les garçons avaient tourné le dos, ils nous prenaient à témoin:
– Pourtant, nous sommes aussi français qu’eux, soupirait mon père.
– Plus français, renchérissait ma mère avec violence. Elle ajoutait en guise d’explication: Nous sommes plus instruits. Nous avons de meilleures manières. Nous lisons davantage. Certains d’entre eux n’ont jamais quitté Paris alors que nous connaissons le Mont-Saint-Michel, la Côte d’Azur et la Côte basque. »
Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs), que Maryse Condé lira plus tard, étudiante à Paris, mettra des mots sur cette expérience. C’est aussi celle racontée par Aimé Césaire: la découverte du racisme; à Paris, ces notables, enviés et respectés chez eux, se découvrent sous un autre regard et prennent conscience qu’ils sont considérés comme des inférieurs. De ce moment date la révolte de Maryse Condé, qui la conduira plus tard jusqu’en Afrique et à devenir écrivaine. A la certitude que ce destin de réussite sociale, comme si de rien n’était, comme si sous le regard des gens croisés en métropole ils n’étaient pas ces Noirs qu’on considère toujours avec au moins un peu de condescendance – à la certitude donc que ce destin n’est pas le sien. La certitude que son milieu ne peut rien lui apporter.
Il y a là la source d’un engagement, notamment politique, sans doute, mais aussi un projet d’écrivain. L’épigraphe, tirée du Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust, est on ne peut plus claire : »Ce que l’intelligence nous rend sous le nom de passé n’est pas lui. » C’est l’indication de la voie choisie par Maryse Condé dans ce livre: un récit conduit à hauteur d’enfant, le ton presque plat épousant les mots, les représentations du milieu familial dont est issue Maryse Condé, incapable de se figurer les tenants et aboutissants de sa condition, et du jeu de dupe que représente pour elle cette ambition de noirs embourgeoisés au point de copier les manières de métropolitains qui ne les considèrent pas comme leurs égaux.
A partir de là, tout un monde resurgit, de chapitre en chapitre: celui d’une petite fille, issue d’une famille respectable de Pointe-à-Pitre, chacun de ces chapitres éclairant l’histoire de ce milieu familial, et du destin à venir de l’écrivaine: un père vieillissant, ancien séducteur; une mère «fille d’une bâtarde analphabète qui avait quitté la Treille pour se louer à La Pointe», qui «avait donc grandi, humiliée par les enfants des maîtres, près du potager des cuisines des maisons bourgeoises»; les dimanches à la messe; la première amourette; les sorties avec les « Jeannettes » – toute une enfance donc, avant que Maryse Condé ne s’engage, après une première année d’études à Paris, en hypokhâgne, dans une toute autre voie. Mais cela, ce sera une autre histoire aussi. Celle des années de révolte, des années africaines, racontées dans La Vie sans fards, le second volume des Mémoires de Maryse Condé.
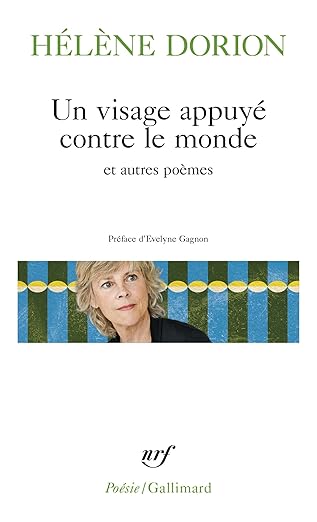
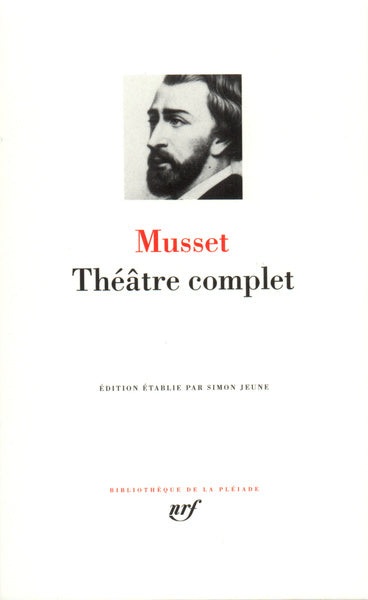

2 commentaires
nathalie · 30 juin 2024 à 14 h 39 min
Donc ça a l’air très complémentaire avec que j’ai lu Victoire, les saveurs et les mots, qui raconte l’histoire de la grand-mère et de la mère et qui est vraiment très bien. Une autobiographie familiale.
Cléanthe · 30 juin 2024 à 16 h 54 min
Victoire est le prochain sur ma liste.