Thomas MANN: La Montagne magique
« Hans Castorp rend visite à son cousin dans un luxueux sanatorium de Davos, en Suisse. Piégé par la magie de ce lieu éminemment romanesque, captivé par des discussions de haut vol, il ne parvient pas à repartir. Le jeune Allemand découvre son attirance pour un personnage androgyne et, au mépris du danger, se laisse peu à peu envoûter par cette vie de souffrances, mais aussi d’aventures extrêmes en montagne et de dévergondage, où fermentent des sentiments d’amour et de mort. Écrite entre 1912 et 1924, La Montagne magique est l’un des romans majeurs du vingtième siècle. Cette œuvre magistrale radiographie une société décadente et ses malades, en explorant les mystères de leur psychisme. Évocation ironique d’une vie lascive en altitude, somme philosophique du magicien des mots, ce vertigineux «roman du temps» retrouve tout son éclat dans une nouvelle traduction qui en restitue l’humour et la force expressive. » (4e de couverture)
La Montagne magique est un de ces monuments de la littérature tout aussi fascinant pour qui en entame la lecture qu’il intimide auparavant. On a comparé souvent La Recherche de Proust à une cathédrale. Et c’est comme ça en effet parfois qu’on y entre. Dès la page de couverture, le roman du Thomas Mann annonce lui aussi le programme. Je ne sais par quelle facétie cependant l’édition du Livre de Poche a placé là le détail d’un tableau représentant le Mont Cervin – le Matterhorn en couverture d’une histoire se déroulant dans les Grisons! Pfff! Mais l’éditeur n’est peut-être pas familier de la géographie suisse ou, ce qui serait plus fâcheux, pense que les lecteurs ne le sont pas. En tout cas cette couverture est assez belle, ce qui l’excuse un peu. La localisation de l’action du roman a cependant son importance, subtilement dramatisée dans les premiers paragraphes: les Grisons, ce sont les confins du monde germanique, un ailleurs, non seulement en hauteur, mais loin vers le sud, dans une région où l’allemand déjà n’est plus qu’une langue seconde. Un monde que le développement du chemin de fer a rendu facilement accessible. Et c’est vers ce monde que, parti de Hambourg, le jeune Hans Castorp s’achemine pour ce qu’il ne croit d’abord être qu’un voyage d’agrément de trois semaines. Ce monde est celui de la montagne annoncée par le titre, une montagne magique, enchantée traduirait-on peut-être mieux, incantata traduit l’italien, mais c’est l’adjectif de magique qui s’est imposé depuis la première traduction du roman en français: un Zauberberg.
Je parlais tout à l’instant de monument. Et justement. Comme le roman de Proust, La Montagne magique invite le lecteur lui-même à une expérience de lecture qui n’est pas le moindre des enjeux du roman. J’en ai moi-même entrepris plusieurs fois l’ascension, interrompu en cours de route par des raisons personnelles extérieures au roman, mais j’avais chaque fois été ébloui par l’extraordinaire dynamique de ce livre. Ma troisième tentative finalement a été la bonne. Je viens de passer trois semaines merveilleuses. Et déjà je vois se dresser une autre montagne, un autre monument intimidant à gravir: celui de parler d’un tel livre.
La façon la plus immédiate serait peut-être d’en suivre tranquillement le cours. La Montagne magique est de ces gros pavés qui d’emblée installent avec le lecteur un lien de connivence, une atmosphère qui fait qu’on sait qu’on s’y sentira bien. Comme Hans Castorp parti rejoindre son cousin au sanatorium de Davos pour trois semaines de vacances, entre la fin de ses études et un premier emploi d’ingénieur naval à Hambourg, j’ai glissé dans le confort de cette lecture, la peinture de ce monde suranné, accompagné par la plume en verve d’un narrateur ironique et facétieux – l’humour étant l’une des réussites de ce chef-d’œuvre, parmi tant d’autres, efficacement rendu par la nouvelle traduction de Claire de Oliveira. Lire La Montagne magique, c’est ainsi ouvrir une parenthèse dans le cours d’une existence dominée par les injonctions, les impératifs et les contretemps – ce qu’au sanatorium Berghof on nomme le monde d’en-bas. C’est faire une expérience singulière de la durée, à l’image du personnage principal du livre – et on verra plus bas que c’est en effet l’un des enjeux principaux du roman.
Parti pour un voyage de trois semaines donc, Hans Castorp finira par y rester sept ans, rappelé seulement au monde d’en-bas par la conflagration des événements historiques: l’éclatement du premier conflit mondial. Sept années et sept chapitres (dans un roman où la symbolique du nombre sept court de page en page, dans une sorte de jeu, de démenti ludique de toute signification de ce chiffre hautement symbolique). Sept chapitres, mais divisant subtilement l’action. D’un chapitre à l’autre, le nombre de pages croit: si les quatre premiers chapitres, narrant les trois semaines initiales du voyage de Hans Castorp, n’occupent qu’un tiers du roman, les chapitres V, VI et VII s’étendent progressivement à la longueur démesurée de véritables romans. Tandis que, par un mouvement inverse, un plus grand espace de durée est embrassé par les chapitres successifs, au point pour le lecteur de perdre quasiment tout repère temporel, tout marqueur chronologique du temps qui va. Les singularités météorologiques, comme la neige qui tombe parfois en plein cœur de l’été, continuent à brouiller les repères.
Les trois semaines que Hans devaient rester au sanatorium occupent ainsi les quatre premiers chapitres – chapitres fascinants (enchantés?) qu’il suffit soi-même de lire pour se trouver happé par la force de ce roman. C’est la découverte du monde à part des sanatoriums de luxe, réservés à une clientèle fortunée, avec son univers de paquebot de croisière ou de palace. Un monde qui n’est pas sans exercer un certain charme, comme Hans en fait lui-même l’expérience, malgré la raison pour laquelle chacun se trouve là: la maladie, la tuberculose – et la proximité de la mort. Ou plutôt à cause d’elle: la maladie, fatale, avec ce qu’elle libère aussi de désir de vivre, d’émancipation des contraintes d’un monde corseté, n’exerce-t-elle pas un charme paradoxal? Thomas Mann s’en était d’ailleurs fait lui-même l’écrivain dans La Mort à Venise. Des repas pantagruéliques, la poussée du désir charnel, le luxe et l’abondance pour conjurer la mort sont quelques uns des motifs de cette fascination paradoxale pour la maladie et de l’élan de vivre qui en surgit – mais sous une face grotesque, toujours parfumée des miasmes de la tuberculose, teintée des tâches pulmonaires (à l’image de la radio de ses poumons offerte par Clavdia Chauchat à Hans Castorp). Ici le roman trouve sans doute sa dimension symbolique: celle d’une société européenne qui, à l’image de la société fortunée du Titanic, danse, sans le savoir encore, sur sa propre tombe. Le motif de la danse macabre, que Mann va puiser dans le fond culturel allemand, donne quelques unes des scènes d’anthologie du roman. La satire sociale n’est jamais loin, avec sa galerie de personnages: Caroline Stöhr, une sorte de Mme Verdurin bis, qui ne peut s’empêcher d’écorcher les mots, le docteur Krokovski, charlatan teinté de psychanalyse qui tient des conférences, auxquelles on est vivement prié d’assister, où l’amour est mis en équation avec la maladie, avant d’explorer plus loin encore les mystères de l’âme avec un petit groupe de pensionnaires choisis en organisant des séances de spiritisme, Hermine Kleefeld, membre des cercles du demi-poumon, capable d’émettre des sifflements stridents avec son pneumothorax… Les modes, les lubies à quoi donnent lieu la vie en vase clos de cette société communautaire ne sont pas le moins amusant des motifs du roman.
On n’insistera jamais assez sur l’ironie de la démarche narrative de Thomas Mann. Interrompant plusieurs fois son récit, soulignant le thème central de son roman par des apostrophes ou des développements autonomes prenant sujet de la question du temps – et notamment du temps narratif et de son écart avec le temps de l’action, l’auteur suit les pas de Hans au sanatorium Berghof comme le faisait déjà Stendhal de Julien Sorel ou de Fabrice del Dongo: avec cette distance (« notre héros » comme l’écrivent aussi bien Stendhal que Mann) qui invite le lecteur à la double expérience de se laisser charmer par une action romanesque incarnée par un héros jeune dont l’immaturité révèle dans le même temps la dimension toute romanesque du propos – portrait d’une jeunesse à la fois séduisante et insatisfaisante, et d’un espace romanesque qui, pour reprendre une expression restée célèbre de Panofsky à propos de la perspective, en serait comme la forme symbolique. Sauf que la forme ici n’est plus d’espace, mais de temps. Et que le roman est cette parenthèse enchantée, fictionnelle (c’est une fiction, ce n’est pas vrai!) où une expérience essentielle cependant nous est donnée à vivre (et dans ce cas-là c’est vrai donc, plus vrai que vrai!). L’arrivée à Davos, la montée au sanatorium, le premier repas, le premier petit déjeuner, la première promenade, la première rencontre avec les médecins, le premier concert, la première conférence, la première facture hebdomadaire…: autant d’expériences – de premières expériences (de « premières fois »), où l’ironie affleure sous le charme et la fascination, d’un univers ritualisé, qui est à la fois celui du sanatorium Berghof et celui de l’espace romanesque. Car loin de guider le lecteur, cette énumération de premiers moments ne sert qu’à l’entraîner dans un mouvement de perte progressive de ses repères temporels, l’initiant au véritable sujet du roman: un roman du temps ou sur le temps.
On touche enfin à la question essentielle: avec A la Recherche du temps perdu et Mrs Dalloway, La Montagne magique est en effet un roman du temps, un roman non pas seulement sur le temps, mais où quelque chose d’une expérience renouvelée du temps se donne. A l’époque où Bergson construit son œuvre philosophique qui cherche à libérer l’appréhension de la durée vécue du temps spatialisé des représentations scientifiques, le sujet est au centre de certaines des expériences esthétiques les plus novatrices. Chez Proust, c’est la question de la mémoire, chez Virginia Woolf la tension entre le temps des horloges et l’expérience intérieure de la durée qui viennent renouveler la conception même de l’écriture romanesque et l’expérience de la lecture. L’ironie de Mann, peut-être plus proche de Bergson que les deux précédents pour des raisons que je n’aurai pas le temps de développer ici, est que cette expérience nouvelle du temps (et donc aussi de l’œuvre romanesque) se fasse en un lieu clos – le sanatorium – où l’emploi du temps est dominé par une computation obsessionnelle (premier petit déjeuner, promenade, deuxième petit-déjeuner, longues heures de repos, etc.) dans une parodie des emplois du temps qui régissent le monde d’en bas.
Dans les très belles pages qu’il consacre à La Montagne magique dans le 2e volume de Temps et Récit, Paul Ricoeur relève que si La Montagne magique est bien un roman du temps, c’est tout autant un roman de la maladie mortelle et un roman du destin de la culture européenne, accordant une place considérable aux conversations et controverses. L’effacement du temps, la fascination pour la maladie, la décadence de la culture européenne (la tentation du nihilisme), autant de motifs, en effet, réunis par Thomas Mann dans la figure de son personnage principal, Hans Castorp, et dans ses expériences. Car, en même temps qu’un roman du temps, La Montagne magique est aussi celui d’une formation spirituelle, celle d’un jeune homme que se disputent deux des figures centrales du roman: Settembrini, rationaliste, homme des Lumières, républicain, franc-maçon, et Naphta, un jésuite, arrivé tardivement dans le roman, qui professe un inquiétant catholicisme, mélange de mysticisme et de violence. En faisant de Hans l’objet de convoitise de leur enseignement, en développant en une logorrhée débridée et souvent contradictoire l’opposition des deux hommes, Thomas Mann tient la position en surplomb de l’écrivain facétieux trouvant à naviguer ironiquement entre les différents plans symboliques de son œuvre: le récit de la mort de l’Europe (annonçant la guerre de 14) et le récit d’une quête spirituelle (celle de Hans Castorp).
La Montagne magique est ce que dans la littérature allemande on appelle un Bildungsroman, un roman de formation. Ou, mieux, un anti-roman de formation, comme on l’a relevé parfois. Il est vrai que le trait parodique est patent, dans la mesure où y manque la dimension essentielle au genre – en tout cas tel que Goethe en a défini le modèle dans son Wilhelm Meister – de la mise à l’épreuve de l’action. Mobilité et intériorité – le roman de formation avance sur deux jambes. Or dans le monde du sanatorium Berghof où rien ne se passe, on peinera à trouver place pour une action, sinon des parodies d’action, avant la fin du roman, dans la guerre, qui est justement le moment où l’on perd de vue le personnage. En même temps qu’un roman de formation donc, en reprenant les codes et jouant avec eux, La Montagne magique serait la mise à distance du roman de formation, une sorte de jeu parodique avec les références goethéennes qui, au-delà du genre du Bildungsroman, il est vrai, abondent: notamment celles au Faust et à sa Nuit de Walpurgis – titre d’une des sections les plus importantes du roman. On ne saurait cependant dire de Hans qu’il n’apprend rien et remiser son illumination spirituelle au titre des fantaisies romanesques. Face à ces deux beaux parleurs que sont Settembrini et Naphta, que leur opposition révèle comme des rhéteurs stériles, Hans reste un apprenti insoumis, épris de liberté, résolu à échapper à ses formateurs. Se former par soi-même – voilà au fond l’expérience dont Hans est le héros, à la fois du côté de la sensualité et de celui d’une sorte de sentiment océanique de la vie, expérience à la fois exaltante, mais terrifiante aussi, qui culmine dans deux des moments majeurs de l’œuvre: la section Nuit de Walpurgis qui clôt le chapitre V et, dans un tout autre registre, la section Neige du chapitre VI: échangeant enfin avec Clavdia Chauchat, la femme sensuelle et libre, aux traits kirghizes qui lui rappelle l’adolescent dont les traits le fascinaient au collège, Hans entame avec elle, dans l’atmosphère renversée d’une nuit de carnaval, un duo de séduction (en français!) dont l’auteur a la facétie de ne pas nous dire jusqu’où il les conduit; parti à ski dans la montagne, Hans s’y abandonne à une illumination poétique, avant d’être désorienté par la neige et menacé de ne pas retrouver le chemin du sanatorium. La tentation de la sensualité d’un côté, l’illumination quasiment mystique, de l’autre, au-delà de la révélation (bergsonienne) de la durée, du sentiment océanique, cosmique du temps – deux espaces quasi sauvages, en prise directe avec le vrai mouvement de la vie, à distance de l’univers feutré et protégé du sanatorium où la mort elle-même est masquée .
Peut-être une autre tradition romanesque mériterait ici d’être convoquée: celle du roman de formation à la française qui, de Stendhal à Flaubert, trace un autre sillon que la grande route goethéenne du Bildungsroman, dont bien des interprétations du roman de Thomas Mann retiennent qu’il s’éloigne parodiquement. A rebours des héros d’une littérature allemande, pressés de devenir quelqu’un – ce que nous raconte justement le Bildungsroman, les écrivains français, d’emblée peut-être ironiques et auto-parodiques à l’égard du genre, on su mettre en scène des personnages qui, à l’instar de Hans Castorp, n’arrivent à rien, ou semblent n’arriver à rien, mais restent prisonniers pour ainsi dire de leur jeunesse, soit que la mort sauve in extremis le héros romanesque de la banalité de la vie bourgeoise (Julien, Fabrice), soit qu’il se retourne des années plus tard sur une jeunesse au goût d’inachevé (L’Education sentimentale). Et je crois que c’est à cette tradition-là, plus qu’à un dépassement parodique du roman goethéen que se livre Thomas Mann dans La Montagne magique. La confrontation avec Goethe aura lieu, dans Le docteur Faustus. Mais, pour l’heure, il me semble plus important d’insister sur les multiples références à la littérature française qui constituent comme une sorte de trame narrative sous-terraine au roman de Thomas Mann, mais que les limites de ce billet (déjà hors-limites) m’obligent, hélas, à résumer: référence à Balzac (l’entrée en scène de Naphta présentée, comme dans un roman de Balzac, à partir de la description de son salon), hommage à Maupassant (l’échange, en français, courant sur une quinzaine de pages entre Hans et Clavdia), inspiration bergsonienne (dans les développements de l’auteur sur le temps), et bien d’autres encore.
Je touche à la fin de ce billet, et je me rends compte que je n’ai pas parlé encore de nombreuses choses que j’aurais voulu développer: le personnage du docteur Behrens (figure ambigüe, appliqué autant à soigner qu’à retenir ses malades); le passage des saisons et les belles descriptions qui leur sont associées (car, comme L’Arrière-Saison de Stifter, La Montagne magique, ce Zeitroman, est aussi un Wetterroman, un roman du temps qu’il fait); le talent avec lequel Thomas Mann arrive à relancer l’action, dans un roman où il ne se passe rien, ou presque, qui désoriente notre sens de l’enchaînement des événements, grâce à un art consommé de l’introduction de nouveaux personnages (l’extraordinaire Peeperkorn, dont je n’ai pas trouvé le loisir de parler non plus, et qui est cependant l’une des plus grandes réussites du roman) et une reprise des moments attendus d’une action romanesque (rebondissements, entrées et sorties de scène, baiser, etc.). Une dernière question se pose, sur laquelle je n’ai pas trouvé à lire: qui est le narrateur de La Montagne magique? Il me semble que la réponse est moins aisé qu’il ne semble. Mais je dépasserais là encore, à essayer d’y répondre, les limites déjà trop distendues de ce billet.
Alors, tentés par l’ascension de la Montagne magique? C’est une expérience en tout cas qui vaut bien des excursions réelles. Et ce n’est pas le moindre des charmes de ce livre: la fascination qu’il exerce et continue d’exercer bien après la lecture. J’avoue ne pas être encore sorti de cette fascination. Et avoir peiné un peu ces dernières semaines à commencer d’autres lectures, toujours trop fades par rapport à l’envoûtement d’un roman de la trempe de celui de Thomas Mann. Même ce billet a été particulièrement long à écrire. Et je n’en suis sorti qu’en me lançant dans un autre pavé, lu une première fois il y a déjà bien longtemps et qui avait illuminé mon adolescence: Les Illusions perdues de Balzac, que je compte bien cette fois enchaîner avec Splendeurs et misères des courtisanes. Histoire à suivre…
« En son for intérieur, Hans Castorp n’observait donc pas cet ordre qui sert à l’homme, dans sa gestion du temps, à contrôler son déroulement, à le séparer en unités qu’il compte et dénomme. Il n’avait pas pris garde à la silencieuse survenue du dixième mois; seules les choses sensibles l’affectaient, comme cette chaleur torride du soleil surplombant et recelant de secrètes gelées, sensation dont l’intensité était nouvelle pour lui, et qui lui inspirait une comparaison culinaire: elle lui rappelait, il s’en était ouvert à Joachim, l’omelette norvégienne, avec sa glace sous une meringue bien chaude. Il tenait souvent des propos de ce genre, avec aisance et animation, comme un être qui, malgré sa peau brûlante, a le frisson. Il est vrai que, le reste du temps, il était taciturne, pour ne pas dire renfermé, car si son attention se dirigeait vers l’extérieur, c’était vers un seul point; tout le reste, êtres et choses, se perdait dans le brouillard, un brouillard engendré par le cerveau de Hans, que le conseiller Behrens et le docteur Krokovski auraient sans doute perçu comme le produit de toxines solubles; l’homme à la tête embrumée se le disait souvent, sans que ce jugement suscitât la faculté ou le moindre désir d’être délié de son ivresse.
Cette ivresse, en effet, uniquement préoccupée d’elle-même, ne trouve rien de plus importun et détestable que le dégrisement. Elle ne cède pas non plus aux impressions susceptibles de la tempérer, ne les tolère pas, afin de se préserver. Hans Castorp savait une chose qu’il avait lui-même énoncée: de profil, Mme Chauchat n’était pas à son avantage, elle avait les traits accusés, plus très jeunes. Et quelle en était la conséquence? Il évitait de la regarder de profil, fermait littéralement les yeux quand d’aventure elle lui offrait cette vue, de près ou de loin, qui lui faisait mal. Pourquoi? Sa raison aurait dû entrevoir avec joie l’occasion d’avoir le dessus! Mais c’était trop demander… Il pâlit de ravissement lorsque Clavdia, durant ces jours splendides, apparut au second petit déjeuner dans le déshabillé de dentelle blanche qu’elle portait par temps chaud, et qui lui donnait un charme hors du commun: en retard et dans le fracas de la porte, elle l’arborait toute souriante, levant à demi les bras à une hauteur inégale, faisant face à la salle pour se présenter. Or ce qui enchantait Hans n’était pas qu’elle fût à son avantage, c’était de savoir qu’il en était ainsi: cela renforçait le doux brouillard qu’il avait dans la tête, cette ivresse désireuse d’elle-même, soucieuse d’être légitime et alimentée. »
(Chapitre V – « Caprices de Mercure »)
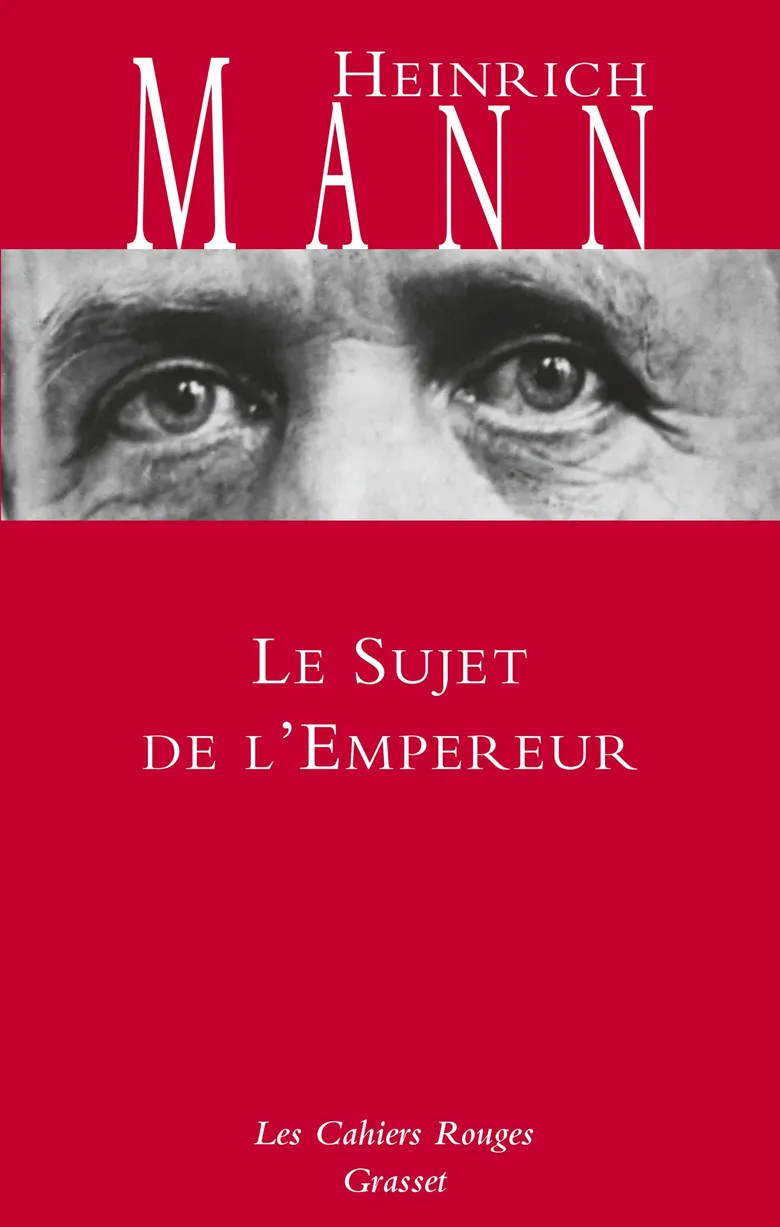

14 commentaires
Dominique · 18 juin 2023 à 8 h 51 min
Voilà le billet parfait, celui qu’on lit lentement avec le sourire aux lèvres
j’ai le même respect et intérêt pour ce roman, ce roman d’avant l’écroulement de l’Europe, la disparition d’un monde. Je compte le relire cet été ma première lecture ayant été faite sans réelle conviction mais à un moment peu propice trop parasitée à l’époque par le travail.
c’est un été riche que je me prépare avec en parallèle mon volume de Steinbeck
Bravo encore pour ce billet car souvent je peine à écrire pour certains livres et souvent ceux qui m’importent le plus
Cléanthe · 12 octobre 2023 à 7 h 24 min
Merci pour ton commentaire, même si je réponds horriblement tard. Alors, comment s’est passé ton été?
doudoumatous · 19 juin 2023 à 5 h 30 min
J’ai lu « La montagne magique » lorsque j’étais étudiante. Je pense, qu’à l’époque, je suis passée un peu à coté. Je n’ai pas détesté mais je n’ai pas été très enthousiaste non plus. Il y a des romans qui demandent peut-être un peu de maturité. Ton billet rend un bel hommage à ce livre.
Cléanthe · 12 octobre 2023 à 7 h 21 min
Peut-être une relecture…?
Patrice · 22 juin 2023 à 12 h 55 min
Quel billet magnifiquement écrit et particulièrement riche ! Le hasard veut que ce matin, je l’ai feuilleté dans une librairie, mais je n’ai pas encore sauté le pas. J’aurais dû lire ta chronique avant !
Cléanthe · 12 octobre 2023 à 7 h 21 min
Je réponds un peu tard, mais j’espère que depuis tu as sauté le pas…
keisha · 1 juillet 2023 à 7 h 02 min
Je n’ai lu ‘que’ les Bruddenbrooks, mais là ça m’a l’air d’être un livre à connaître absolument. Dominique a aussi ce projet. Si c’est du niveau de Proust et Woolf, c’est prometteur.
Cléanthe · 12 octobre 2023 à 7 h 20 min
Oui, aussi grand que Proust et Woolf. Et si j’ai beaucoup aimé les Buddenbrooks, j’ai trouvé La Montagne magique plus extraordinaire encore.
manou · 15 août 2023 à 8 h 10 min
Un livre que j’ai lu il y a très longtemps et qu’il me faudrait relire un jour tant à l’époque il m’avait marqué tout en étant persuadée que je passais à côté de beaucoup de choses…Merci pour cette belle chronique qui me donne envie de m’y (re)plonger quand j’aurais un peu de temps devant moi…
Cléanthe · 12 octobre 2023 à 7 h 19 min
C’est un livre que je relirai aussi un jour, je pense. Je ne sais plus où j’ai lu d’ailleurs que l’impression en est changée justement quand on sait où le roman nous mène. Comme si Thomas Mann l’avait écrit pour être lu et relu justement.
Bonheur du Jour · 6 octobre 2023 à 4 h 53 min
Merci beaucoup : votre article est très intéressant et il me fait penser qu’il me faudrait reprendre ce livre magistral, lu il y a tant d’années. Une nouvelle lecture maintenant me permettrait sans doute de percevoir tant d’autres choses… Et, pourquoi pas, relire tout Thomas Mann durant un hiver. Oui, à réfléchir.
Bonne journée.
Cléanthe · 12 octobre 2023 à 7 h 17 min
Tout Thomas Mann pendant un hiver… belle ambition! Dans un endroit calme et bien au chaud, ça fait rêver en effet.
Tania · 12 novembre 2023 à 11 h 49 min
Ah, quel chef-d’œuvre ! Oui, c’est une lecture qui nous emporte comme si en même temps que là où nous sommes nous faisions un séjour ailleurs – et à la fin nous pouvons dire : « Je viens de passer trois semaines merveilleuses. »
J’ai rouvert « La montagne magique » il y a quelques années avec, comme la première fois, ce sentiment de bonheur. Dans mes deux tomes au Livre de Poche de 1988-1989, : Hans (I) et Settembrini (II), les acteurs du film de Hans W. Geißendörfer (1981), figurent en couverture et pour moi cela correspond bien à ce qui fait l’étoffe du roman : l’observation des personnages, leurs discussions, les relations qui se nouent entre eux.
Cléanthe · 12 novembre 2023 à 18 h 29 min
J’ai avec ce livre une histoire un peu compliquée liée à des moments heureux ou moins heureux de ma vie. Bref, je l’ai commencé plusieurs fois, et j’ai dû pour des raisons diverses m’en éloigner plusieurs fois. A chaque fois, j’ai adoré cependant ce que la lecture m’en promettait. La première fois, c’était dans l’édition dont tu parles. Mais la nouvelle traduction dans laquelle je suis finalement allé au bout du livre est incomparable, dans la mesure où elle rend aussi tout l’humour, toute l’ironie de Thomas Mann, et nous restitue l’impression d’un auteur beaucoup plus léger et impertinent.