Stefan ZWEIG: La Pitié dangereuse
Une gaffe, une simple gaffe, et le désir de réparer la gaffe, tel est parfois le tour étrange que vous joue le destin… Quelques mois avant la guerre de 14, Hofmiller, futur héros de la Grande Guerre, est un jeune lieutenant de cavalerie en service dans une modeste ville de garnison hongroise, peu éloignée de Vienne. Convié à un bal chez les von Kekesfalva, Hofmiller découvre avec plaisir ce qu’il prend pour le faste d’une grande famille hongroise, se délecte des plats qu’on lui tend, abuse des vins qu’on lui propose, danse avec de belles jeunes filles, jusqu’à la gaffe finale qui va céler irrémédiablement son destin : invitant à danser la jeune fille de la maison, Hofmiller n’a pas pris attention au fait que celle-ci était paralytique. Incapable d’affronter la crise que sa demande provoque chez la jeune Edith, Hofmiller s’enfuit de la maison…
Bien sûr, il faut aimer la manière psychologique de Stefan Zweig, cet art de la narration que certains jugeront facile, mais qui fit en son temps le succès de l’écrivain, le mythe de l’Autriche-Hongrie que celui-ci aima à construire de récit en récit, ainsi qu’une certaine ironie, caractéristique justement de ce ton de la Mitteleuropa dont Zweig fut l’un des principaux écrivains. Je conçois qu’on puisse rester indifférent à ce style. Mais il y a dans la fausse simplicité de Zweig, comparable en mon sens à celle d’un Hermann Hesse – ou d’un film de Max Ophüls – une humanité qui me touche, une élégance, que je ne retrouve guère en France par exemple que dans le cinéma de Jean Renoir, et qui fait tout le prix de ses récits.
Peut-être suis-je conduit tout naturellement à Jean Renoir à cause de l’évocation de la vie de caserne qui, si elle n’est qu’un développement secondaire du roman de Stefan Zweig, en est cependant l’un des morceaux les plus réussis. Il y a dans cette petite ville de garnison tout le charme provincial d’un pays qui a été un jour l’Autriche-Hongrie. Les camarades aux noms d’origines diverses, l’ordre intérieur qui règne dans la petite communauté, le destin même de Kekesfalva, petit juif de Galicie qui après avoir réussi par un travail acharné – et des affaires plus ou moins douteuses – finit par racheter la propriété et le titre d’une vieux château hongrois, avant de connaître la rédemption de l’amour et de la paternité, portent la nostalgie d’un monde disparu, tenu par l’ordre cosmopolite et la coexistence de différentes classes nationales et sociales. Zweig s’est fait le romancier de cet ordre disparu, ce rêve d’une Europe enfoui sous les aspirations nationalistes – un rêve naïf qu’incarne son héros, Hofmiller, à travers le récit ironique de cet homme conduit par ses bons sentiments et qui finit par provoquer une tragédie. La musique, les fêtes conviviales, la bonne humeur constituent l’arrière-plan d’une société cependant conventionnelle aussi et parfois un peu rigide dans ses traditions, telles ces soirées qu’organisent entre eux les officiers de la garnison dans le café du coin, ou cette scène de mariage paysan qu’Hofmiller, Edith, Ilona et Kekesfalva découvrent au hasard d’une excursion portée par le rêve d’une guérison de la jeune paralysée.
Si Hofmiller campe un personnage de naïf un peu trop sûr de sa bonté et de son innocence, incapable de se hisser à la hauteur de la pitié qu’il éprouve pour Edith von Kekesfalva, et qui tarde à comprendre l’amour fou, la tempête émotionnelle que sa présence quasi quotidienne auprès de la malade déchaîne en elle, Edith, la fille malade de Kekesfalva, devenue paralysée à la suite d’un virus est sans doute le personnage le plus interessant du roman. Avec elle, Zweig plonge dans la psyché d’une femme handicapée. Devenue la principale préoccupation d’un père richissime prêt à sacrifier sa fortune à son bonheur et à une guérison éventuelle, Edith est une jeune femme passionnée, capable d’une violence de sentiments qui l’élèvent, mais la font vite retomber, un être que la maladie rend aussi parfois tyrannique. Le tableau de cette maisonnée tournant tout entière autour de la jeune fille est une des grandes réussites du roman : de son père, hanté littéralement par la maladie de sa fille, à sa belle cousine, Ilona, repoussant un mariage et les effets que sa séduction exerce pour s’occuper de sa jeune cousine, et jusqu’aux domestiques eux-mêmes dont les états émotionnels semblent commandés par l’humeur d’Edith.
Cette famille bien sûr est un piège, dans lequel le lieutenant Hofmiller va bientôt se prendre, d’abord guidé là par le charme de la belle Ilona et le plaisir de banquets somptueux, mais incapable de repousser les effets de cette satanée pitié qui le pousse lui-même à se mettre au service des attentes de cette maisonnée, confrontée aux limites de ce que la fortune ne peut donner. Il y a là bien sûr un motif quasiment fantastique, que Zweig prend la fantaisie d’exploiter à l’occasion de certaines pages. Invité à se hisser à la hauteur de son destin par le docteur Condor, une sorte de double positif du héros qui a fait du dévouement aux autres le mobile de sa vie, Hofmiller ne saura pas se montrer digne de l’attitude chevaleresque que le destin lui présente et ne deviendra un héros sur le champ de bataille que par hasard, pour ainsi dire, ou conduit par son désir d’expier. L’ironie du destin d’Hofmiller – qui échoue dans sa vie à sauver Edith, mais est célébré socialement comme un des héros de la Grande Guerre – n’est pas sans rappeler le mélange de grandeur et de décadence que Joseph Roth mêle tout aussi ironiquement pour évoquer l’Autriche-Hongrie finissante dans son chef d’oeuvre, La marche de Radetzky, là aussi à partir de l’évocation de la vie militaire.
« Ce soir-là j’étais Dieu. J’avais créé le monde, et il était bon et juste. J’avais donné la vie à un être humain, son front brillait, pur comme le matin, et dans ses yeux se reflétait l’arc-en-ciel du bonheur. J’avais couvert la table de richesses, de mets délicieux, de vins, de fruits, de fleurs. Magnifiquement présentés, ces témoins de ma générosité étaient pour moi autant de présents, ils s’avançaient vers moi dans des plats resplendissants et des corbeilles pleines, et le vin coulait, les fruits étincelaient, ils s’offraient doux et délicieux à ma bouche. J’avais apporté de la joie dans la pièce et de la lumière dans le coeur des hommes. Dans les verres scintillait le soleil du lustre, la nappe de damas brillait comme de la neige, et je voyais avec fierté que les hommes aimaient la lumière qui sortait de moi, et j’acceptais leur amour et je m’en enivrais. Ils m’offraient du vin, et je le buvais jusqu’au fond du verre; ils m’offraient des fruits et des plats, et leurs dons me réjouissaient. Ils me montraient du respect et de la gratitude, et j’accueillais leurs hommages comme j’acceptais les mets et les boissons
Ce soir-là j’étais Dieu. »
Billet publié dans le cadre des Feuilles allemandes 2022
Une lecture commune proposée par Patrice & Eva à l’occasion des Feuilles Allemandes et de Lire autour du handicap.
Y ont participé Brize, Keisha, Patrice, Anne-yes, Ingannmic
Stefan Zweig, La Pitié dangereuse (Ungeduld des Herzens, 1939), in Romans et Nouvelles 1, La Pochothèque

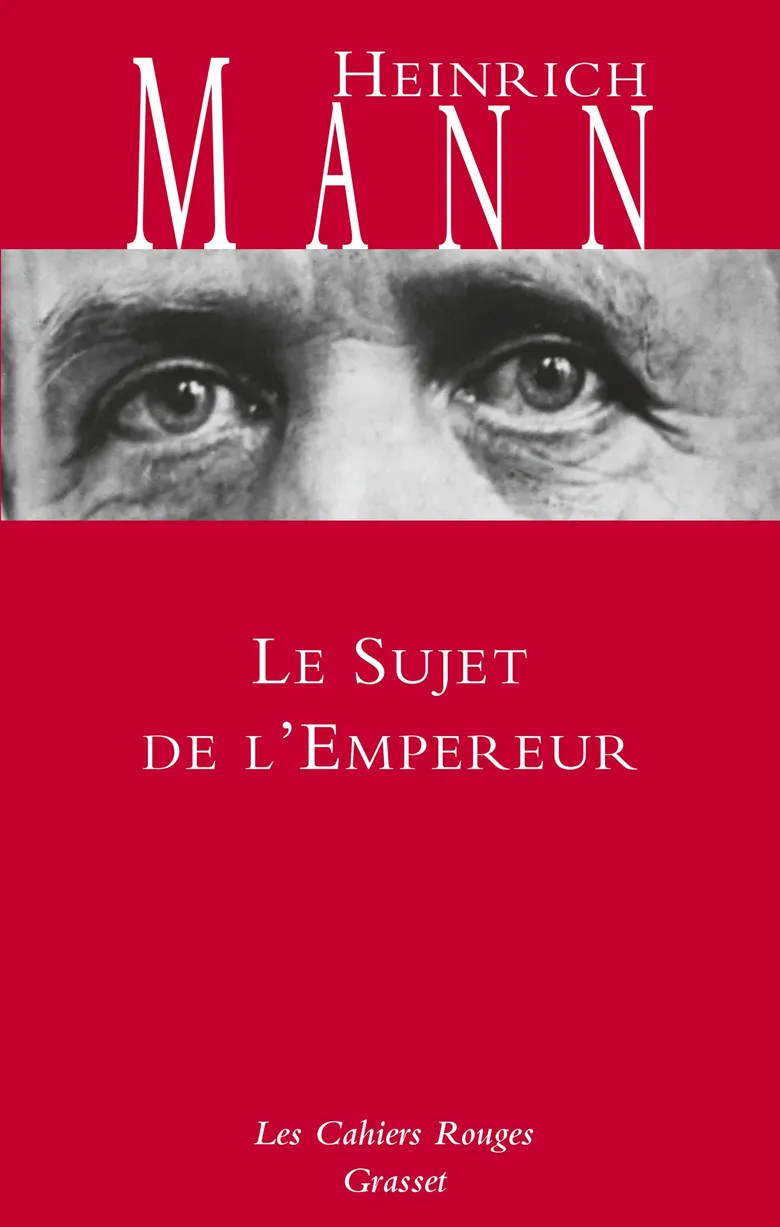

21 commentaires
doudoumatous · 28 novembre 2022 à 15 h 19 min
Bonjour, je découvre ce blog grâce aux « Feuilles allemandes ». C’est très intéressant ces lectures communes.
Cléanthe · 29 novembre 2022 à 1 h 05 min
Bienvenue dans mon carnet de lecture! Je découvre moi aussi ton blog du coup par la même occasion.
doudoumatous · 29 novembre 2022 à 9 h 42 min
Merci ! A bientôt, je pense.
miriam panigel · 28 novembre 2022 à 15 h 37 min
lu l’an passé pour les Feuilles Allemandes 2021, je reviens toujours à Zweig. Quelle finesse !
Cléanthe · 29 novembre 2022 à 1 h 07 min
Je n’ai pas beaucoup lu Zweig. Mais j’apprecie moi aussi la finesse de ces récits psychologiques.
Patrice · 28 novembre 2022 à 16 h 58 min
Très belle chronique et très belle analyse de cette Autriche-Hongrie ainsi que de la personnalité d’Edith. Je souscris totalement à ce que tu écrit.
Cléanthe · 29 novembre 2022 à 1 h 08 min
Merci. Cette LC a été l’occasion pour moi de découvrir un texte inspirant, dont j’aurais attendu encore longtemps pour le lire, je crois. C’est tout l’intérêt de ces rencontres.
Marilyne · 28 novembre 2022 à 19 h 11 min
S.Zweig fait partie de mon panthéon. Je me retrouve dans ton premier paragraphe. Je l’ai lu de façon monomaniaque ( comme Duras plus tard :)) il y a longtemps. J’y reviens parfois. Celui-ci, je l’ai lu et relu, quelle finesse. Ton approche, le rapprochement avec Joseph Roth, est plus que pertinent ( et me donne envie de revenir à lui aussi ).
Cléanthe · 29 novembre 2022 à 1 h 10 min
J’étais plutôt dans Joseph Roth ces temps-ci. Mais cette LC a été l’occasion de revenir à Zweig, un auteur que j’avais peu lu finalement.
Ingannmic · 28 novembre 2022 à 20 h 03 min
Je rejoins Patrice : quel excellent billet, très complet, et très fin ! Et j’apprécie le rapprochement final avec La marche de Radetzky, que j’ai lu pour les Feuilles Allemandes 2021, et beaucoup aimé.
Cléanthe · 29 novembre 2022 à 1 h 11 min
Merci à toi aussi. La Marche de Radetzky, lue il y a très longtemps (au moins deux décennies) est un de mes romans favoris sans doute. Je me dis bien souvent qu’il faudrait que je le relise.
A_girl_from_earth · 29 novembre 2022 à 0 h 13 min
Comme je le disais chez les autres lectrices qui ont lu également ce roman, je crois bien que c’est mon premier Zweig, lu il y a bien longtemps, et j’en garde encore un souvenir fort !
Cléanthe · 29 novembre 2022 à 1 h 38 min
J’en garderai un très beau souvenir je crois moi aussi.
Brize · 29 novembre 2022 à 8 h 25 min
Très beau billet, que j’ai lu avec intérêt !
Cléanthe · 30 novembre 2022 à 0 h 18 min
Merci Brize! C’est que cette lecture m’a inspiré…
keisha · 29 novembre 2022 à 9 h 14 min
Billet vraiment bien senti, j’en découvre! Il faudrait bien que je pense plus souvent à Zweig pour mes lectures, même si j préfère e plus courtes nouvelles.
Cléanthe · 30 novembre 2022 à 0 h 20 min
Il va falloir que je me mette aux nouvelles, pour rattraper le temps perdu, car j’ai très peu lu Zweig jusqu’à présent.
Agnès · 29 novembre 2022 à 9 h 41 min
Très belle critique. Excellent ce passage où il dit qu’il est Dieu.Il m’a, moi aussi, particulièrement frappée.
Cléanthe · 30 novembre 2022 à 0 h 21 min
Oui, j’ai trouvé ce passage saisissant, et si caractéristique de la tendre ironie de Zweig.
Dominique · 1 décembre 2022 à 11 h 28 min
C’est toujours un grand plaisir de lire ou relire Zweig
pour moi le summum c’est toujours son journal d’un européen mais j’aime ses nouvelles et ses romans et quand je lis un bille comme celui là j’ai aussitot l’envie d’aller piocher dans ma bibliothèque
Cléanthe · 1 décembre 2022 à 13 h 01 min
Je ne connaissais pas trop Zweig, et c’est vrai que ce roman m’a bien donné envie de poursuivre ma lecture de cet auteur. Je note son Journal.