Véronique OLMI: Bakhita
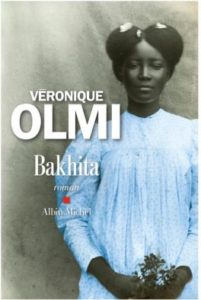 Elle ne s’appelle pas encore Bakhita. Elle est alors une petite fille, une enfant, vivant auprès de ses parents comme le font tous les enfants, ou comme ils devraient pouvoir le faire, dans un village du Darfour, où elle aime déjà à raconter des histoires aux autres enfants, à tenir les plus petits tout près d’elle. De ce village, de sa langue, de son nom même, elle oubliera bientôt tout, ou presque. Enlevée à sept ans, elle est réduite en esclavage, passe de maîtres en maîtres, subit la soumission, les violences, les tortures, le viol. Un jour, elle est rachetée par le consul d’Italie, qui la ramène avec lui en Europe…
Elle ne s’appelle pas encore Bakhita. Elle est alors une petite fille, une enfant, vivant auprès de ses parents comme le font tous les enfants, ou comme ils devraient pouvoir le faire, dans un village du Darfour, où elle aime déjà à raconter des histoires aux autres enfants, à tenir les plus petits tout près d’elle. De ce village, de sa langue, de son nom même, elle oubliera bientôt tout, ou presque. Enlevée à sept ans, elle est réduite en esclavage, passe de maîtres en maîtres, subit la soumission, les violences, les tortures, le viol. Un jour, elle est rachetée par le consul d’Italie, qui la ramène avec lui en Europe…
C’est le livre de la rentrée, dont tout le monde parle, un formidable succès de librairie. Je me tiens habituellement éloigné de ces engouements saisonniers – sans doute parce que j’aime prendre le temps de laisser se construire le désir d’un livre, sa nécessité. J’ai plongé, cette fois-ci, pour des raisons diverses, dont la principale tient au destin de cette Bakhita – comme pour beaucoup des lecteurs qui s’arrachent le livre ces temps-ci, c’est une découverte: cette femme née dans un village dajou du Darfour à la fin du XIXème siècle, tombée en esclavage à l’âge de sept ans, entrée dans les ordres en Italie, où elle traversera les deux guerres mondiales, le fascisme, devenue en 2000 sainte Joséphine Bakhita, à l’issue de sa canonisation par Jean-Paul II. Au croisement de l’histoire de l’esclavage et des stratégies d’appropriation de ce parcours hors du commun par le pouvoir politique ou religieux, ce destin avait tout pour me séduire. Et le livre de Véronique Olmi, malgré quelques réserves qui ne sont apparues que dans les 100 dernières pages, est une belle réussite.
Car c’est d’abord un très beau livre, très émouvant, d’une force littéraire accomplie. Un uppercut à la poitrine dit sur son blog Eve. Je suis d’accord. Difficile devant un tel livre de ne pas sentir plusieurs fois monter les larmes. L’émotion est au comble. Grâce à une gradation discrète mais efficace, Véronique Olmi donne de l’esclavage dans le nord-est africain au XIXème siècle une description à la limite du soutenable. Ce sont les pages les plus fortes du livre sans doute. Surprenante d’abord par sa concision, une forme de sécheresse qui dans les trente premières pages donnerait presque l’impression de ne rien accrocher, la langue de Véronique Olmi impose peu à peu sa nécessité, se gonfle à l’occasion, recherche à tout moment une précision qui permet de reconstituer sans pathos un destin pathétique. Il est difficile de raconter dans l’espace d’un billet ces pages sombres, mais magnifiques: la longue marche des esclaves où aucune vie, même celle des nourrissons, n’est respectée, l’évocation à la fois si violente et si pudique des violences sexuelles subies par Bakhita ou des tortures, bien d’autres scènes encore parviennent à donner un contenu sensible à la réalité de l’esclavage, sans jamais verser dans le discours moralisateur ni dans le débordement de bons sentiments.
Il y a quelque chose de théâtral dans ce dispositif bien sûr. Véronique Olmi écrit aussi pour le théâtre. L’émotion comme moyen de combler la distance entre cette destinée étrangère, cette trajectoire spirituelle de chair et de sang et notre propre vie. On appelle cela l’incarnation. Et il est intéressant que cette question qui est celle du théâtre soit aussi celle du christianisme. Je vous laisse découvrir par quel chemin Bakhita, esclave soudanaise, finira par rejoindre l’Italie et par entrer dans les Ordres. Il y a aussi quelque chose de romanesque dans ce destin. Et je ne voudrais pas gâcher ce romanesque.
C’est, m’a-t-il semblé, la deuxième réussite de ce livre: évitant l’écueil du récit d’édification religieuse, Véronique Olmi trouve à raconter de l’intérieur la rencontre de Bakhita avec le dieu chétien. Une rencontre qui est d’abord celle de l’Italie (de belles pages sur Gênes, sur Venise). Qui se nourrit de la conscience que le destin de ceux qui souffrent est partout le même sur la Terre, que si l’esclavage est une indignité qui place celui qui l’a subi toujours en position de dominé, une courbure qu’aucun acte d’affranchissement ne pourra jamais effacer, il est aussi une richesse intérieure qui donne à celui qui l’a vécu la compréhension intime de ce que vivent tous ceux qui souffrent. La rencontre de Bakhita avec la figure souffrante de Jésus crucifié et son entrée, à Venise, au couvent est un des moments très émouvants du livre. Je connais peu de descriptions aussi inspirées, aussi sensibles du véritable sentiment amoureux qui peut envahir le chrétien sinon quelques belles pages de Zola (mais qui traite cet amour sous l’angle de la pathologie) ou de Thérèse d’Avila (mais qui brûle d’un tel feu qu’on peine parfois à la suivre).
Le livre de Véronique Olmi aurait pu s’arrêter là. J’ai moins été convaincu en effet par la deuxième partie du roman. Les longues années de vie religieuse de Bakhita, la popularisation de son histoire dans l’Italie fasciste, au moment où le régime décide d’envahir l’Ethiopie, auraient mérité, me semble-t-il, un autre livre. Instrumentalisée par le régime, peut-être aussi par son propre ordre religieux, Bakhita restera au fond cette esclave à quoi l’ont réduit à sept ans les trafiquants d’esclaves. Le jeu du pouvoir fasciste, la collusion avec le pouvoir de certains religieux, la porosité entre évangélisation et colonisation sont des aspects du destin de Bakhita qui auraient demandé à être étayés. Le service de Dieu impose-t-il qu’on accepte tous les esclavages? Même celui de rendre une visite au Duce? J’aurais aimé que Véronique Olmi ne se contente pas d’effleurer ces questions.
Mais son livre demeure cependant un très beau livre.
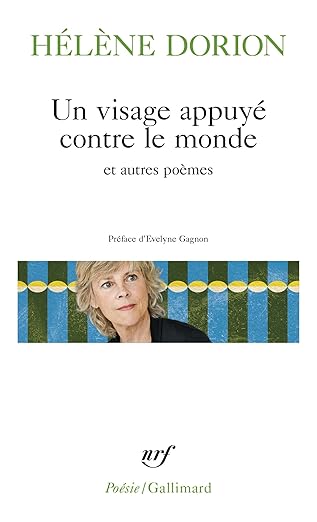
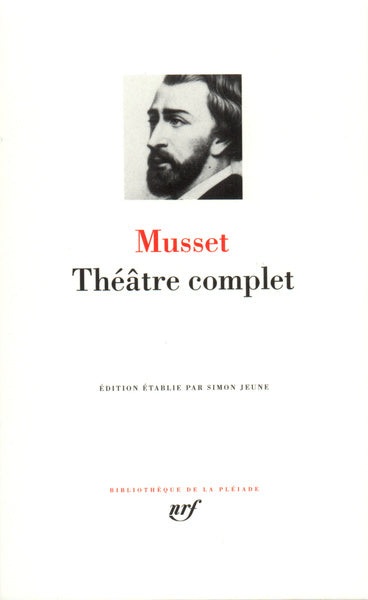

8 commentaires
Eve-Yeshé · 17 décembre 2017 à 13 h 42 min
même ressenti, la dernière partie aurait gagné à être un peu plus approfondi, la récupération par l’Église
c’est une femme exemplaire par sa résilience et sa spiritualité
Cléanthe · 17 décembre 2017 à 15 h 18 min
Je suis rassuré que tu partages la même impression, car je m’étais demandé si je n’étais pas un peu passé à côté de la fin du livre. Mais tout ce qui précède est vraiment très réussi.
Ellettres · 20 décembre 2017 à 10 h 24 min
Tu synthétises très bien les forces et les enjeux de ce livre et en même temps, de relire un avis dessus cela me redonne le frisson ! J’avais été trop émue par cette lecture pour pouvoir prendre quelque distance. Cette enfant esclave m’a tellement bouleversée et les descriptions des pratiques esclavagistes sont tellement insoutenables… tu as raison sur la dernière partie, j’avais moins accroché. Je suis contente que Véronique Olmi ait permis de « découvrir » Bakhita de son voile sulpicien.
Cléanthe · 20 décembre 2017 à 12 h 38 min
Oui. Le talent de Véronique Olmi est de savoir donner corps à ce destin. La description de l’esclavage est le passage le plus émouvant (à la limite parfois du soutenable) qui a retenu avec raison l’attention. Mais j’aime beaucoup aussi l’épisode de l’arrivée en Italie puis de l’entrée au monastère, à Venise. Il règne sur ces pages quelque chose de lumineux qui éclaire brusquement ce destin.
Lili · 20 décembre 2017 à 14 h 37 min
Je viens de voir que ce titre avait été élu pour le prix des blogueurs littéraires ! J’en ai lu de beaux échos, notamment sur le blog d’Ellettres. Je note que tu as été moins convaincu par la deuxième partie. Malgré ce bémol, tu rends honneur à ce titre. J’espère le découvrir prochainement ! 🙂
Cléanthe · 20 décembre 2017 à 16 h 21 min
Le bémol est à la mesure de tout ce qui précède, et qui est vraiment réussi. Je te conseille vraiment ce roman.
Lilly · 28 décembre 2017 à 10 h 02 min
Malgré les avis dithyrambiques, je n’étais pas du tout tentée par ce roman, mais ton billet commence à m’intriguer. On verra si j’arrive à le caser dans toutes les lectures que j’ai prévues pour les prochaines semaines.
Cléanthe · 1 janvier 2018 à 13 h 02 min
Tu verras, c’est un livre tres émouvant.