Jérôme FERRARI: Le sermon sur la chute de Rome
 Un petit bar, un bistro, comme il en existe dans d’autres villages corses. Le pastis, les histoires qu’on se raconte en montant le ton, la bonhomie des hommes au retour de la chasse, les parties de belote. Une nuit, Hayet, la serveuse, disparaît, sans laisser de traces ni d’adresse. Le moment pour Marie-Angèle, la patronne, de passer la main. Difficile de se libérer de la charge de son commerce! Finalement, deux garçons, Libero et Matthieu, deux étudiants en philo, des gars du pays revenus de Paris, tournant le dos à leurs études, se proposent de reprendre le troquet. Mais que vaut notre aspiration au bonheur confrontée à la fragilité des royaumes terrestres ? N’y a-t-il pas quelque folie à vouloir faire perdurer un monde au-delà de sa destruction ? Et quelle place ici bas pour nos rêves de contentement autarcique ?
Un petit bar, un bistro, comme il en existe dans d’autres villages corses. Le pastis, les histoires qu’on se raconte en montant le ton, la bonhomie des hommes au retour de la chasse, les parties de belote. Une nuit, Hayet, la serveuse, disparaît, sans laisser de traces ni d’adresse. Le moment pour Marie-Angèle, la patronne, de passer la main. Difficile de se libérer de la charge de son commerce! Finalement, deux garçons, Libero et Matthieu, deux étudiants en philo, des gars du pays revenus de Paris, tournant le dos à leurs études, se proposent de reprendre le troquet. Mais que vaut notre aspiration au bonheur confrontée à la fragilité des royaumes terrestres ? N’y a-t-il pas quelque folie à vouloir faire perdurer un monde au-delà de sa destruction ? Et quelle place ici bas pour nos rêves de contentement autarcique ?
Le roman de Jérôme Ferrari, si le titre n’en était pas déjà si beau, aurait pu s’appeler La Blessure. Dans ce roman, dont on parle beaucoup – et avec raison – en cette rentrée littéraire, il semble en effet que l’auteur ait cherché à se faire le chroniqueur sensible des blessures qui déchirent les hommes : ruptures, fissures, écarts, écartèlements, basculement de mondes. Ce sont les formes d’une expérience douloureuse de soi, de son impossible inscription dans un monde. Comme l’écrit Jérôme Ferrari,
pour qu’un monde nouveau surgisse, il faut d’abord que meure un monde ancien. Et nous savons aussi que l’intervalle qui les sépare peut être infiniment court ou au contraire si long que les hommes doivent apprendre pendant des dizaines d’années à vivre dans la désolation pour découvrir immanquablement qu’ils en sont incapables et qu’au bout du compte, ils n’ont pas vécu.
Libero, le fils d’immigrés sardes, monte à Paris – une consécration – pour découvrir en Sorbonne la vanité des commentaires philosophiques. Matthieu, son ami, débarque en Corse poussé par son rêve d’une petite société parfaite et ses plus beaux souvenirs de vacances – rêve d’insularité qui, depuis Thomas More au moins, est celui de toutes les aspirations utopiques – et prend sa part de responsabilité dans un jeu qui conduit autour de lui chacun à dégénérer dans les formes les plus sordides de l’existence : alcool, prostitution, violence. Aurélie, sa sœur, archéologue spécialiste de l’Antiquité tardive, rencontre, sur un chantier de fouilles, un confrère algérien et cherche à donner vie, dans ses bras, à son rêve de réconciliation des deux rives de la Méditerranée, de ce temps où de la côte du Maghreb résonnait la voix fragile, mais puissante de saint Augustin ; pourtant, elle doit renoncer à cet amour que la distance politique et économique menace de transformer en frustrations, en blessures multiples. Marcel Antonetti, leur grand-père, voit sa vie coincée entre la figure d’un père absent, mort à la guerre de 14, et la douleur de devoir affronter la mort de son propre fils, d’un cancer. Sa vie est l’expression d’un vide qui se confond avec le cours de notre violent XXème siècle, siècle de déchirures et de privations, dont Marcel fait l’expérience douloureuse. Mais sa douleur reste vaine, elle aussi. Pour lui, pas de condition héroïque, militaire dont, semblable peut-être à l’héroïsme velléitaire des personnages de Stendhal, sa conscience enfle – rêve de châteaux en Espagne, d’un monde gonflé comme une baudruche.
Les personnages de Jérôme Ferrari sont des personnages désœuvrés. L’expérience qu’ils font est radicale. Le véritable talent de cet auteur est sans doute de trouver à faire résonner cette dimension morale, métaphysique avec une attention contemporaine aux anfractuosités de l’existence humaine, un regard réaliste, dans le ton parfois du roman social, des littératures policières. Ce qui ne va pas sans difficultés cependant. Car comment se faire le chroniqueur des blessures des hommes, de notre besoin de philosophie, sans rajouter le commentaire aux commentaires, sans rajouter sa voix à la glose du monde ? Y a-t-il encore place aujourd’hui pour un discours de consolation ? L’idée très belle de Jérôme Ferrari, et efficace sur le plan littéraire, se trouve justement dans le référence à saint Augustin dont la voix, à travers les âges, nous parvient pour mettre notre désarroi contemporain en résonance avec l’expérience de ces hommes du IVème siècle qui virent eux aussi un monde s’effondrer. Cette voix, celle du sermon sur la chute de Rome, prononcé par Augustin en décembre 410, Jérôme Ferrari la tresse avec plusieurs histoires, celle de Marcel, celle du café de Marie-Angèle, celle de Matthieu et de Libero, celle d’Aurélie qui se croisent et se recroisent, créant un être de papier du fil des existences vides, de l’expérience de la rupture, de la séparation – mais l’œuvre de littérature est-elle autre chose que cela, au-delà des aspirations et des croyances desquelles il n’y a peut-être aucun salut à espérer: une tentative précaire de consolation ? Et c’en est une très belle, quoique (parce que?) désespérée, que nous livre Jérôme Ferrari dans son dernier roman.
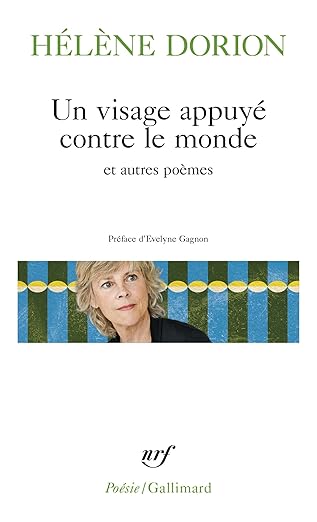
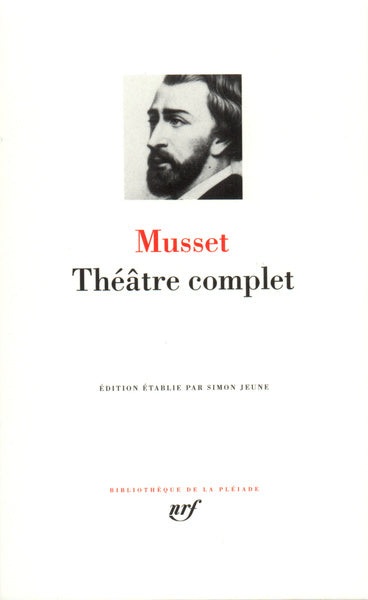

6 commentaires
urgonthe · 21 septembre 2012 à 0 h 00 min
Prix littéraire, prix littéraire… On me dit que ce roman est très bien. Je suis étonnée cependant qu’un prof de philo s’adonne à un tel pessimisme désespéré. Je croyais que la philosophie
permettait d’atteindre le bonheur !
Stephie · 21 septembre 2012 à 0 h 00 min
Très envie de le lire. Encore plus depuis l’annonce du Goncourt 😉
Titine · 21 septembre 2012 à 0 h 00 min
Quel brillant article ! J’ai noté dès la rentrée ce livre de Jérôme Ferrari, j’espère pouvoir le découvrir bientôt.
Hendiadyn · 21 septembre 2012 à 0 h 00 min
Très bel article sur un superbe livre.
Je découvre ton blog avec plaisir ! (via le Hérisson lecteur, par hasard ;))
Cléanthe · 22 septembre 2012 à 0 h 00 min
@Urgonthe: il y a aussi une forme de sourire qui passe dans ce roman, une attention aux hommes. Mais la philosophie ne peut rien contre le destin tragique des individus et des
nations… En tout cas, prix littéraire ou pas, je t’en conseille vivement la lecture.
Cléanthe · 22 septembre 2012 à 0 h 00 min
@Stephie: c’est un roman très réussi en effet.