Joyce Carol OATES: Nous étions les Mulvaney
 Le milieu des années 1970, dans une petite ville du nord de l’Etat de New-York. Les Mulvaney sont une famille bien tranquille: Mike, entrepreneur reconnu et Corinne, les parents, deux fils, une fille, un fils, Mike junior, Patrick, Marianne et Judd. Autour d’eux des animaux, auxquels on donne des noms, comme s’ils étaient des membres de la famille, et tous ces objets d’antiquité que maman réunit. Un potager. Le travail de la ferme. Des amis sans cesse à la maison. Une image du bonheur américain. La nuit de la Saint-Valentin 1976, à l’issue d’une soirée arrosée, tout bascule. Emportant avec elle, comme la robe de bal déchirée que Marianne remise dans son placard, les membres de ce qui jadis fut un clan, lambeaux qui s’éloignent et se rapprochent au gré d’aventures, d’histoires désormais individuelles…
Le milieu des années 1970, dans une petite ville du nord de l’Etat de New-York. Les Mulvaney sont une famille bien tranquille: Mike, entrepreneur reconnu et Corinne, les parents, deux fils, une fille, un fils, Mike junior, Patrick, Marianne et Judd. Autour d’eux des animaux, auxquels on donne des noms, comme s’ils étaient des membres de la famille, et tous ces objets d’antiquité que maman réunit. Un potager. Le travail de la ferme. Des amis sans cesse à la maison. Une image du bonheur américain. La nuit de la Saint-Valentin 1976, à l’issue d’une soirée arrosée, tout bascule. Emportant avec elle, comme la robe de bal déchirée que Marianne remise dans son placard, les membres de ce qui jadis fut un clan, lambeaux qui s’éloignent et se rapprochent au gré d’aventures, d’histoires désormais individuelles…
Il y a bien sûr l’événement effroyable, ça comme dit Mike, le père, incapable même de le nommer, dont le récit, à sa manière lente et détachée, décrit les répliques successives qui finissent par saper les bases apparemment bien assurées de cette famille exemplaire. « Joyce Carol Oates épingle l’hypocrisie d’une société où le paraître règne en maître et érige en roi les princes bien pensants », lit-on sur le quatrième de couverture. C’est à voir! Car à mesure que le récit avance, on ne peut pas s’empêcher de se demander où est la cause véritable du délitement familial, si ce qui est survenu dans la nuit de la saint-Valentin n’est pas qu’une coïncidence, un alibi à mettre en rapport avec d’autres causes possibles du dispersement de toute une famille: des trajectoires individuelles d’abord qui conduiront chacun à assumer son destin personnel; le poids des conventions familiales, ces petites histoires qu’on se raconte pour se faire croire que tout va bien, toute une idéologie du clan, ici un croisement du christianisme et du parti démocrate, sans lesquelles il n’y a pas de famille, mais à partir desquelles – et en réaction auxquelles – chacun des enfants doit se construire; enfin les déterminations personnelles, de l’ordre du parcours individuel, de l’ordre du non dit, cette face cachée du bonheur familial, qui explique par exemple la trajectoire du père, Mike, et sa réaction face aux différents membres de sa famille.
Joyce Carol Oates utilise plusieurs fois l’image du patchwork pour caractériser la vie de certains de ses personnages. C’est ainsi également qu’elle structure son récit. C’est un roman pour amateur de romans réalistes, mais dans une version contemporaine, quelque chose d’ailleurs de relativement commun dans la façon américaine de concevoir le récit, et dont on trouvera le chef d’oeuvre par exemple, au cinéma, dans la construction du film de Coppola, Cotton Club. Fortement digressif, sans cesse le texte déraille, greffant un épisode sur un autre, glissant à l’anecdote. Mais de cette structure en patchwork ressort une unité. Car tout récit censé nous éloigner de la trame linéaire de l’histoire nous ramène en réalité à ce qui fait la matière même de cette histoire d’une famille qui se délite, nous aide à mieux en percevoir la fatalité sourde. Comme dans un patchwork, le retour irrégulier des motifs dit à la fois la récurrence de certains comportements de ces individus qui, quoi qu’ils en pensent, restent des Mulvaney, le poids des déterminismes familiaux, l’imprévu des parcours individuels. C’est le plus beau du texte de Oates: la très belle histoire de Marianne, faite de rencontres singulières, mais qui toutes reproduisent le même schéma, jusqu’à ce qu’elle accepte d’assumer cette histoire que le destin lui propose, et mette un terme à la malédiction de l’agression qui l’a touchée dans sa jeunesse; l’histoire de Mike junior, qui finit par s’engager dans l’armée, afin de transformer une faillite familiale en réussite personnelle, mais dont on ne saura presque rien, parce qu’elle se déroule au loin, au-delà des limites géographiques du récit qui ne s’étendent guère au delà de l’Etat de New-York, à peine jusqu’au nord de la Pennsylvanie; le bel acte de liberté de Patrick qui finit par devenir lui-même en renonçant à une partie de lui-même, et lui aussi s’éloigne un moment, dans ces autres marges du récit que sont le centre et l’ouest des Etats-Unis.
Parmi tous ces motifs, celui du bonheur familial, du bonheur perdu, qui à mesure que le roman progresse apparaît peut-être de plus en plus pour ce qu’il est vraiment: un fantasme. C’est Judd, le plus jeune des fils, devenu journaliste, qui est le narrateur de cette histoire. Un narrateur distant, puisque, régulièrement, on le voit revenir à la troisième personne et parler, y compris de lui, à la manière impersonnelle d’un écrivain naturaliste. Mais où est la réalité dans ce récit composé par et pour une famille? Si Judd cherche souvent à se faire oublier comme je, il n’empêche qu’il est l’un des acteurs de cette histoire, « un complice par instigation et par assistance », dit-il à l’un des moments importants du récit. Et ce bonheur qu’il raconte, c’est celui (dans quelle mesure reconstruit?) auquel se raccroche le cadet de famille, défenseur d’un ordre familial qu’il n’aura quasiment pas connu.
Pour toutes ces raisons, j’ai trouvé le roman de Joyce Carol Oates subtil, intelligent, sensible. Et pourtant, je reste un peu sur ma faim. Comme devant un beau, un grand livre, mais auquel il manque ce quelque chose qui fait l’oeuvre unique. Si Oates sait embrasser, l’air de rien, l’histoire des Etats-Unis, montrer l’envers du rêve américain, la critique sociale n’est jamais frontale, mais latérale, minée par ce doute qui pèse jusqu’à la fin: est-ce les anciens amis des Mulvaney qui se détournent d’eux ou la paranoïa, l’alcoolisme du père qui les fait fuir? Encore une fois, l’écrivain est subtile: l’histoire de cette famille, c’est aussi l’histoire des valeurs familiales au cours de ces deux décennies qui vont de l’élection de Carter jusqu’à celle de Clinton: du rêve communautaire, hippie, hors du carcan familial, jusqu’à un certain renouveau de la famille, en passant par la réaction conservatrice des laissés pour compte lors des années Reagan. Mais là encore, tout est un peu trop bien fait, trop « professionnel ». Joyce Carol Oates m’a donné l’impression d’être de ces écrivains qui ne ratent jamais aucun livre, car elle en possède l’art subtil, la méthode, la manière. Mais je n’y ai pas retrouvé ce quelque chose de plus qu’on trouve par exemple, toujours à propos d’histoire familiale, chez Cynthia Ozik, une de mes découvertes de l’an passé. Mais je ne désespère pas: preuve que malgré ces réserves ce roman m’a plu, j’ai déjà acheté Blonde et Eux, qu’on dit être les deux meilleurs de l’auteur.
Les avis de : Françoise ; Ori ; Keisha ; Manu ; Denis ; Lisa ; Thais ; Papillon ; Gambadou ; Martine ; Marie; ; Jumy ; Soie ; Thracinee ; Grominou ; Taylor ; Chimère ; Armande ;
Autres lectures :
Délicieuses pourritures : Kathel ; Praline ; Ankya
Viol : Stephie ;
Nulle et grande gueule : Alice ; Annie
(d’un autre auteur-sur le thème de la famille :Lou)

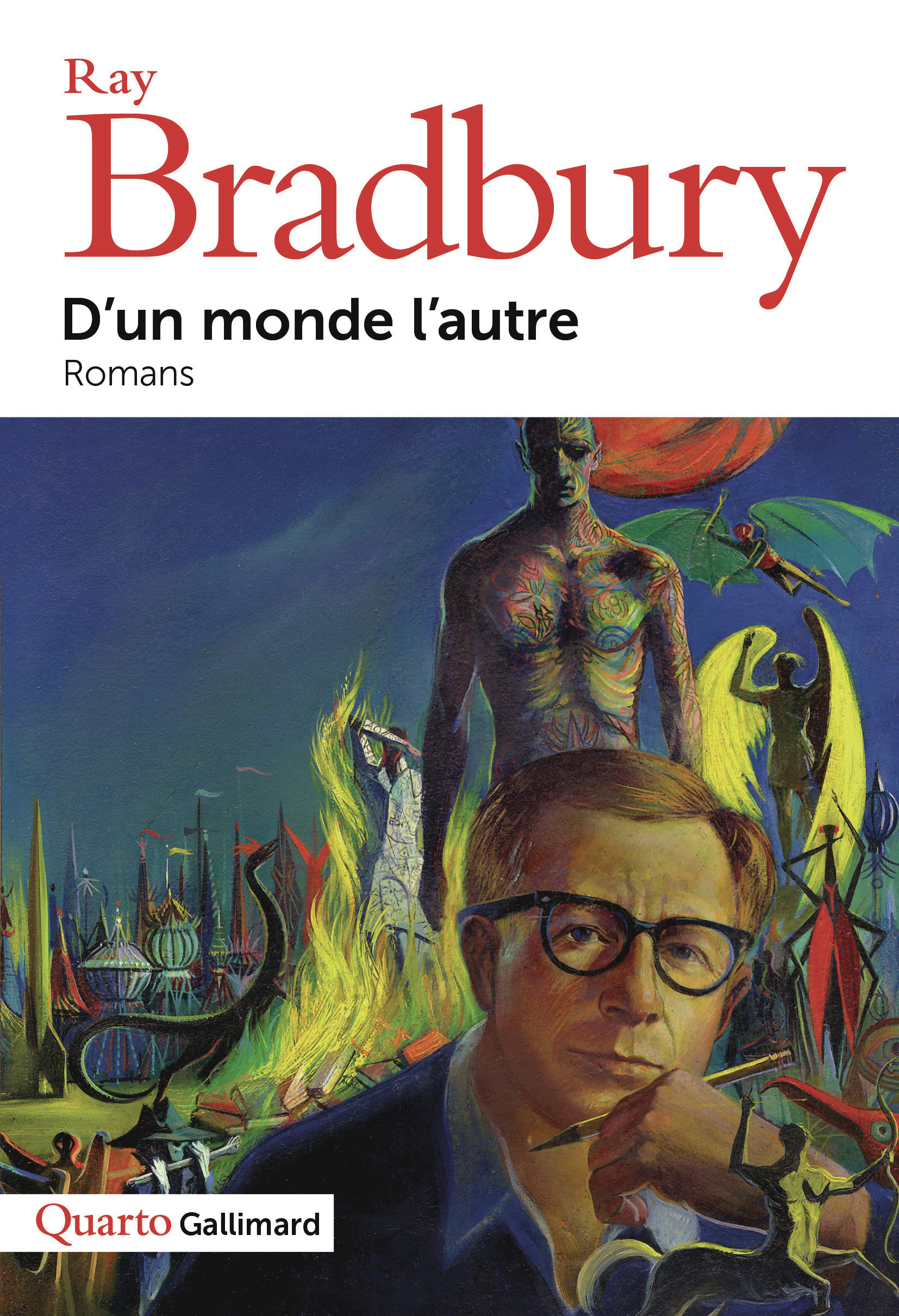
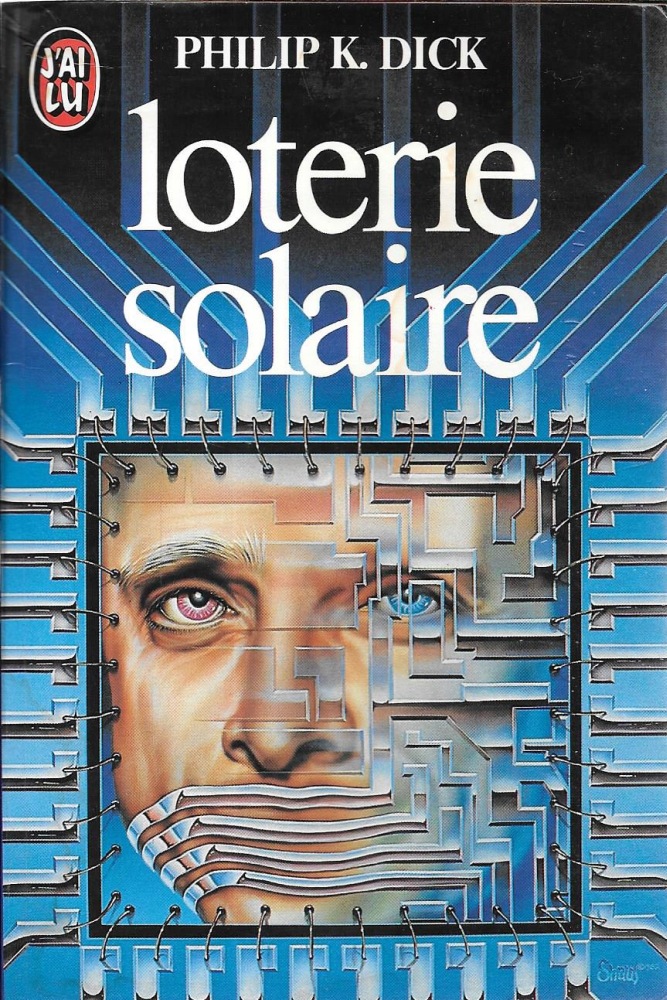
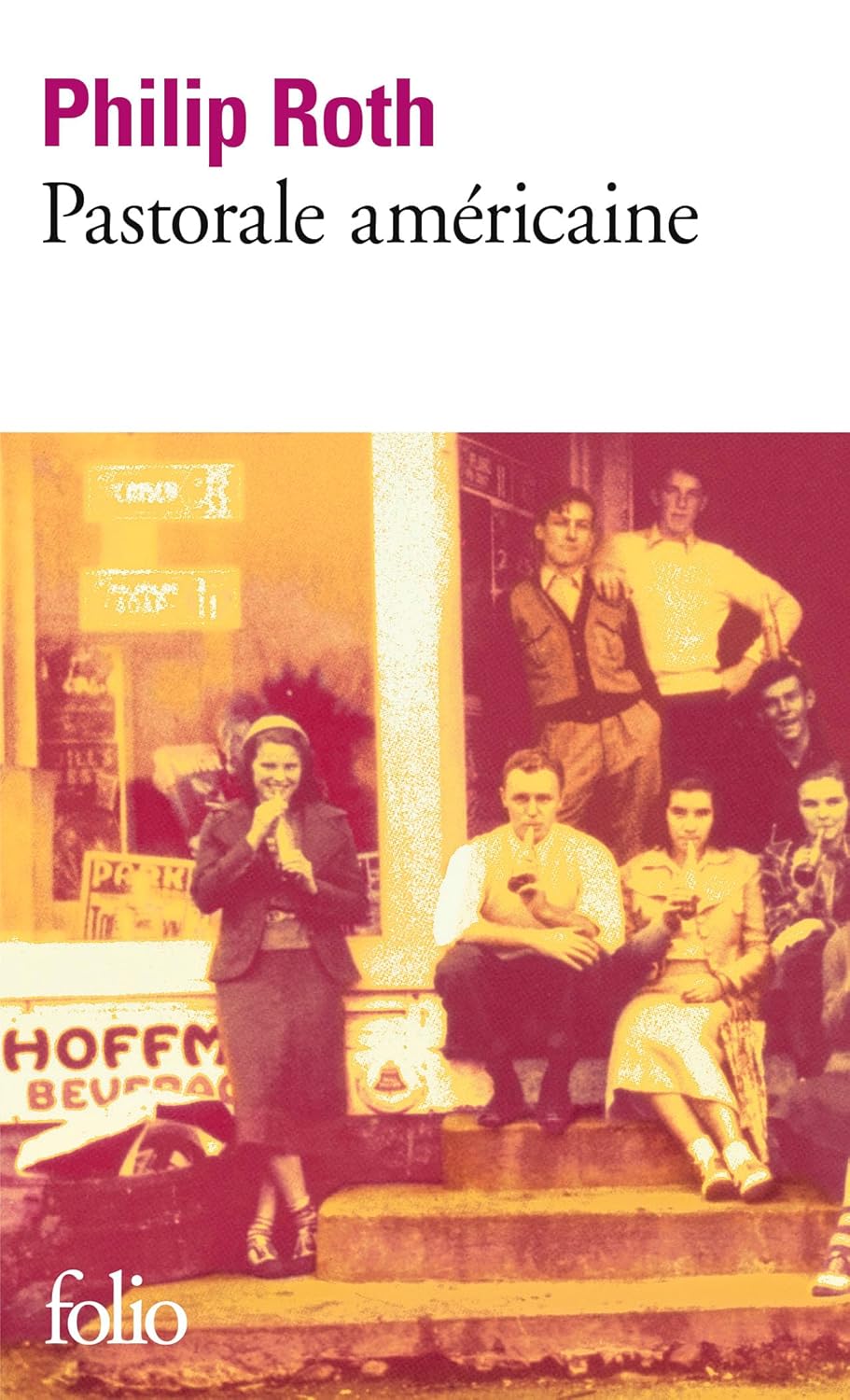
8 commentaires
Lapinoursinette · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Je répète ce qui a été dit mais : bravo pour ton analyse complète et fouillée du roman! Je n’ai pas eu les mêmes réticences que toi même si je peux les comprendre.
Cléanthe · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
@Manu: Je vais essayer de lire d’autres Oates, pour voir si mon impression se confirme.
@ Lapinoursinette: Merci et bienvenue sur ce blog
@ Praline: il FAUT lire Ozik! :o) C’est l’une de mes grandes découvertes de l’an passé.
praline · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Je crois qu’il va falloir que je me frotte à ce titre, je n’en lis que des résumés alléchants. Et je ne connais pas Ozik… Mais tu donnes envie d’aller voir de plus près !
Manu · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Quelle analyse fouillée et profonde ! Il est vrai que je n’ai pas trouvé qu’il manquait ce petit quelque chose et de tous les romans de Oates que j’ai lu, c’est celui que j’ai préféré. Je n’ai pas encore lu ceux que tu cites, mais je sais que « Eux » est un de ses premiers. Je lirai avec plaisir ton avis. J’ai aussi découvert Ozick l’année passée avec « Un monde vacillant » que j’ai beaucoup apprécié mais j’avoue préférer Oates. Je vais voir ton billet sur cette romancière, s’il y en a un.
Ankya · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Je ne lis pas ton billet en entier car je souhaite le lire, lorsqu’il réapparaîtra en poche 🙂 En tout cas j’aime beaucoup ton blog que je viens de découvrir 🙂
Cléanthe · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
@Ankya: Bienvenue sur mon blog. J’attends tes impressions sur les « Mulvaney »
Titine · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Je trouve ton article très intéressant et très juste. Je trouve qu’il y a un problème de distance, de froideur dans le ton de Oates et qui m’avait contaminé dans « Les chutes ». Là c’est vrai que j’y ai trouvé plus d’empathie avec les personnages mais je comprends que l’on puisse émettre des réserves sur cet auteur.
Cléanthe · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
@Françoise: je prends note de tous ces titres, et je suis heureux de voir que tu partages mon jugement sur Cynthia Ozik.
@Lisa: je ne sais pas si nous sommes les seuls à partager ce jugement. je crois n’avoir lu aucun commentaire en ce sens.
@Keisha: bienvenue sur mon blog.
@Titine: mes réserves sont vraiment modérées. J’ai beaucoup aimé le livre, et j’ai encore envie d’en lire d’autres d’elle. Mais tu as raison, c’est peut-être une histoire de ton, de
distance à l’égard des personnages.