Aki SHIMAZAKI: Wasurenagusa (Le Poids des secrets, 4)
Kenji Takahashi a été marié, un mariage sans enfant. Se découvrant stérile après l’échec de son mariage, il s’éprend d’une jeune femme, Mariko, sans origine ni fortune, qui est déjà mère d’un enfant, Yukio. Kenji n’hésite pas à braver sa famille, une famille traditionnelle, pour épouser la jeune femme et adopter l’enfant. Au soir de sa vie, il se met en quête de sa vieille nourrice, Sono, la seule auprès de qui il a éprouvé un peu de chaleur humaine. Sur sa tombe, sur laquelle est gravé le nom des myosotis (wasurenagusa), Kenji finit par découvrir le secret de ses origines…
Kenji Takahashi était un personnage important des trois volumes précédents, mais toujours croisé dans l’ombre d’un autre personnage. C’est son récit de vie qui occupe ce quatrième tome de la série d’Aki Shimazaki, Le Poids des secrets. Curieusement, c’est le livre qui m’a le plus touché dans cette pentalogie et celui sur lequel j’ai spontanément le moins à dire. Peut-être parce que la force de ce quatrième tome tient essentiellement à ces quelques images à travers lesquelles l’autrice porte plus loin que les précédents le motif poétique de l’errance et de la quête des origines. Sans doute ce serait éventer le plaisir du récit que de développer et commenter ces images. L’ouverture du livre – une clochette qui tinte au vent, une brise qui s’en vient caresser la joue de Kenji Takahashi, un signet désignant dans un mot russe des myosotis, et le souvenir de Sono partie en Mandchourie – est à l’unisson d’une construction dans ce livre plus musicale que narrative, et c’est ce qui m’aura touché sans doute.
Il y a aussi la trajectoire du personnage, nouvelle variation sur le motif de la disparition : Kenji s’est construit sur une certitude, qui lui a donné la force d’être ce qu’il est, et découvre que cette certitude est sans fondement. Les effets de miroirs suffisent à suggérer des perspectives que le récit ne confirme jamais, même s’il est semé d’indices : ainsi la possibilité que le prêtre du temple où Kenji finit par retrouver la tombe de Sono soit son véritable père, à moins qu’il ne soit le fils d’un musicien russe. Quelque chose là dedans travaille, comme le dirait la psychanalyse, que j’ai trouvé aussi passionant.
Autre intérêt de ce quatrième roman: l’amour de Kenji et de Mariko. Il fallait un personnage sensible, équilibré et respectueux comme Kenji pour voir se développer les pages d’une sensualité raffinée qui illuminent cet amour. Avec cette langue toute simple, qui fait surgir plutôt qu’elle ne décrit, caractéristique de son écriture, Aki Shimazaki donne au motif rebattu, mais toujours si difficile de la rencontre physique et de la tension du désir des lignes à la fois sans détour et pourtant si pudiques.
Et puisque je parle d’écriture, peut-être est-il temps de développer enfin la question de l’usage de la langue française par Aki Shimazaki que je remets depuis plusieurs billets. Un écrivain s’exprimant dans une autre langue que sa langue maternelle est déjà à soi seul un fait intéressant, que celle-ci soit une nouvelle langue d’écriture, renouvelant la forme de ses écrits, ou celle dans laquelle, au prix d’une sorte de transmutation littéraire, l’écrivain est parvenu à conduire son travail d’écriture. Rien que pour le français les exemples abondent: Beckett, Semprun, Kundera… La singularité de cette autrice est d’écrire sur une réalité intime, le Japon où elle est née et a vécu, et dont elle a longtemps enseigné la langue, dans une langue d’emprunt, acquise tardivement. Il y a dans ce Japon, ces réalités d’un Japon dont l’autrice interroge la destinée intime quelque chose qui se donne mieux peut-être contemplé d’un autre univers linguistique. Les qualités de la langue française – facilité, brièveté, clarté, exactitude -, c’est du moins ce que vantaient les grammairiens du XVIIe siècle, sert une écriture pudique, à la fois apaisée et sans concession, apte à sonder les coeurs, ou plutôt à laisser remonter d’eux, sans jamais y entrer par effraction, ni avec la violence d’images fracassantes, les heurts et malheurs de l’existence. Il y a beaucoup de douceur dans cette écriture, jamais mièvre cependant, toujours précise et affutée. Quelque chose d’une grande manière, mais en mineur ou en sourdine, dont on trouve plusieurs exemples justement dans la littérature de langue française contemporaine.
« Le matin du premier dimanche de mai.
Je suis assis dans un fauteuil de bambou, installé dans l’espace entre la fenêtre et la pièce de tatamis où je me couche. Un vent frais effleure ma joue. Rin… rin… rin… Au-dessus de ma tête, le fûrin de cuivre tinte doucement. Je lève les yeux, mon regard reste immobile quelques instants.
Je tiens un livre dans une main et un signet dans l’autre. C’est un ouvrage pharmaceutique, rédigé par mon collègue, monsieur Horibe. J’en ai grand besoin pour mes recherches. J’essaie de me concentrer, mais j’ai du mal à lire. Mes yeux lisent plusieurs fois les mêmes lignes. Je ne saisis pas bien le sens du contenu. Je me demande: « Qu’est-ce qui me dérange? »
Je regarde distraitement le signet de petites fleurs séchées. La couleur est passée. Au bout est écrit un mot en katakana: niezabudoka. Je ne connais pas ce mot d’origine russe, mais ce doit être le nom de la fleur. il s’agit d’un souvenir envoyé récemment par Sono. Chaque fois que je vois ce signet, je pense à elle. Je la connais depuis mon enfance, elle était ma nurse quand j’avais quatre ans. Elle est maintenant dans la soixantaine. »
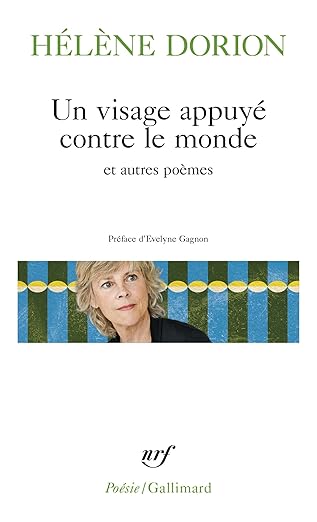
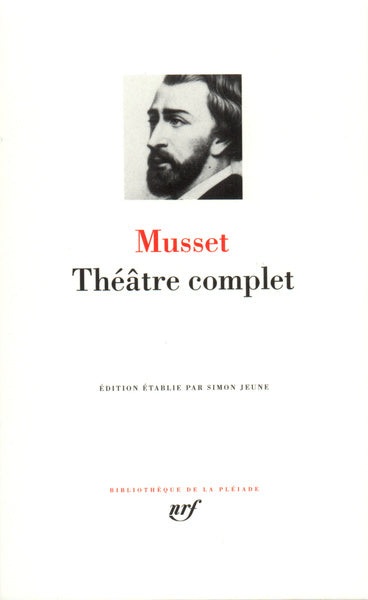

0 commentaire