Joseph Brodsky: Acqua alta
Des années durant, tous les hivers, alors que son enseignement à l’université lui laissait, entre deux semestres, quelques semaines de libre, Joseph Brodsky, le grand poète russe, réfugié aux Etats-Unis après son exclusion d’URSS, s’est rendu à Venise, une Venise froide et brumeuse, vide de ses touristes, baignée par la montée des eaux. Dans cette Venise hivernale, cette Venise liquide, de sang et d’encre, comme une métaphore de la vie, et de l’écriture, Brodsky a beaucoup travaillé, c’est-à-dire écrit, se laissant en poète prendre par cette captation du regard à quoi semble tout entière vouée l’expérience de vivre quelques temps à Venise. Rien de crépusculaire cependant dans cette expérience, pour cet homme des rives de la Baltique que fut Joseph Brodsky. Mais un émerveillement. Une sorte de fascination calme pour cette fantaisie sortie des eaux qu’est Venise, avec son lot de songes et de merveilleux.
Acqua alta est la belle surprise de ce mois-ci. Je découvre en même temps un écrivain qui pour l’instant n’était qu’un nom pour moi: l’exclusion de l’URSS, relevée au temps où je m’intéressais, au sortir de l’adolescence – c’était peu avant la chute du mur de Berlin, aux écrivains de la dissidence et me passionnais notamment pour l’oeuvre de Kundera; le prix Nobel de littérature; le titre d’un volume de Poésies chez Gallimard. Voilà à peu près tout ce que j’associais jusqu’alors au nom de Joseph Brodsky. Quelques lignes citées par Dominique Fernandez dans Le Piéton de Venise, dont j’aurai à reparler d’ici peu, a été l’occasion d’ouvrir enfin un livre de l’écrivain, et de découvrir qu’il était aussi, à côté d’un poète écrivant en russe et traduisant en anglais ses propres textes, l’auteur d’essais subtils et vivifiants, comme des sortes de longs poèmes en prose, rédigés pour l’essentiel directement en anglais. Malheureusement, ces essais ont été fort peu traduits en français – paresse des éditeurs français à défendre de grands textes ou bien légèreté des lecteurs ne permettant pas à de tels livres de trouver leur public? je ne sais. En tout cas tout Brodsky a été traduit en italien, et très bien, y compris sa poésie, de l’aveu même de l’auteur qui retrouvait dans le rythme de l’italien la scansion de la langue russe. Et je compte bien profiter d’un petit séjour printanier dans une des îles de la lagune pour me procurer l’essentiel de ses essais et de sa poésie.
Joseph Brodsky en effet est de ces écrivains qui emportent, dès la première ligne:
« Il y a de cela des lunes, le dollar valait 870 lires et moi j’avais trente-deux ans. Le globe de son côté était plus léger de deux milliards d’âmes, et le bar de la stazione où je venais d’arriver par cette nuit froide de décembre était désert. »
Cette Venise, dans un récit à la fois plein d’humour et profondément poétique, Joseph Brodsky va s’efforcer d’en reconstruire l’expérience. Et il y a fort à faire lorsqu’il s’agit justement de Venise. La passion de Brodsky pour Venise ne s’enracine pas pour rien dans la découverte des romans d’Henri de Régnier, un écrivain qu’on ne lit plus, à tort, au temps où Venise ne pouvait au mieux être encore pour lui qu’un nom, ou un fantasme inaccessible. C’est donc une fois à l’Ouest, à 32 ans, que dépensant son premier salaire Joseph Brodsky prend un billet d’avion et débarque à Venise. Les circonstances en sont elle-mêmes amusantes: dans cette gare vide et glaciale, attendant une italienne très élégante, mais aussi très en retard, spécialiste de poésie russe, plus précisément de Maïakovski et… membre du PCI! A rebours du cliché d’une ville crépusculaire, Brodsky confesse ne pas trop aimer le roman de Thomas Mann, La Mort à Venise. Pas plus que le film de Visconti, visionné dans une copie en noir et blanc, au temps où il vivait encore en URSS, à l’occasion d’une projection semi-clandestine. Trouver à revivifier les images qu’offre au regard une ville aussi pétrifiée de clichés que Venise n’est pas le moindre des tours de force de Joseph Brodsky. Le poète joue tout autant avec le décor d’une ville pour amoureux, filant la métaphore d’une cité labyrinthique, où passent les figures du Minotaure, de Thésée, de Phèdre, d’Ariane et de Pasiphaé. Une descente du Grand Canal, de nuit, entre une rangée de palazzi comme une troupe de cyclopes endormis, la déambulation dans un palais vide reflétant dans ses miroirs éteints le sombre de la nuit, une visite à la veuve d’Ezra Pound, débitant toujours la même rengaine pour tâcher d’amnistier la responsabilité du poète américaine dans ses collusions avec le fascisme sont autant d’étapes d’un parcours qui trouvent surtout à se nourrir du motif, sans cesse renouvelé, de la ville marine: ruelles qui courent sinueuses comme des anguilles, cathédrales étalant leurs concrétions de saints comme des méduses, plan même de la ville qui fait penser à des poissons, antre d’un vieux palais parcouru comme l’épave d’un galion engloutie par les eaux. Dans cette ville d’eau, il ne reste plus qu’à chausser ses bottes, et laisser peut-être le temps courir, comme le fait Joseph Brodsky au cours d’une de ses pérégrinations, et trouver refuge à écouter une messe débitée dans une langue à laquelle il ne comprend rien, entre flot et musique, dans l’église qui fut celle où fut justement baptisé Antonio Vivaldi! Vivaldi dont la musique, jamais crépusculaire, emportée par un torrent de vie, accompagna, et sauva sans doute, les heures les plus douloureuses de sa vie.
« Il ne reste qu’à lire ou arpenter les rues au hasard, ce qui revient à peu près au même car la nuit ces étroits boyaux de pierre sont comme des travées entre les étagères d’une bibliothèque immense et oubliée, et comme elle silencieux. Tous les ‘livres’ sont soigneusement fermés et l’on ne peut en deviner le contenu que grâce aux noms inscrits au dos, en dessous de la sonette. C’est là que vous les trouverez, tous vos Donizetti et vos Rossini, vos Lully et vos Frescobaldi! Peut-être même un Mozart, peut-être un Haydn. Ces rues sont encore comme les étagères d’une penderie: tous les vêtements sont en tissus sombre qui peluche, mais les doublures sont de rubis et d’or étincelant. Goethe appelait ce lieu la « république des castors », mais peut-être Montesquieu visait-il plus juste avec son péremptoire ‘un endroit où il devrait n’y avoir que des poissons’. Car, par moments, de l’autre côté du canal, deux ou trois fenêtres illuminées, hautes et arrondies, à demi voilées de gaze ou de tulle, laissent entrevoir un chandelier tentaculaire, la nageoire laquée d’un piano à queue, un bronze opulent qui encadre des huiles brunes ou rougeâtres, la cage thoracique dorée des poutres d’un plafond – on a l’impression de regarder à l’intérieur d’un poisson à travers ses écailles, et à l’intérieur il y a une réception. »
(pp.86-87)
Joseph BRODSKY, Acqua alta, traduit de l’anglais par Benoît Coeuré et Véronique Schiltz, Gallimard, collection Arcades, 1992
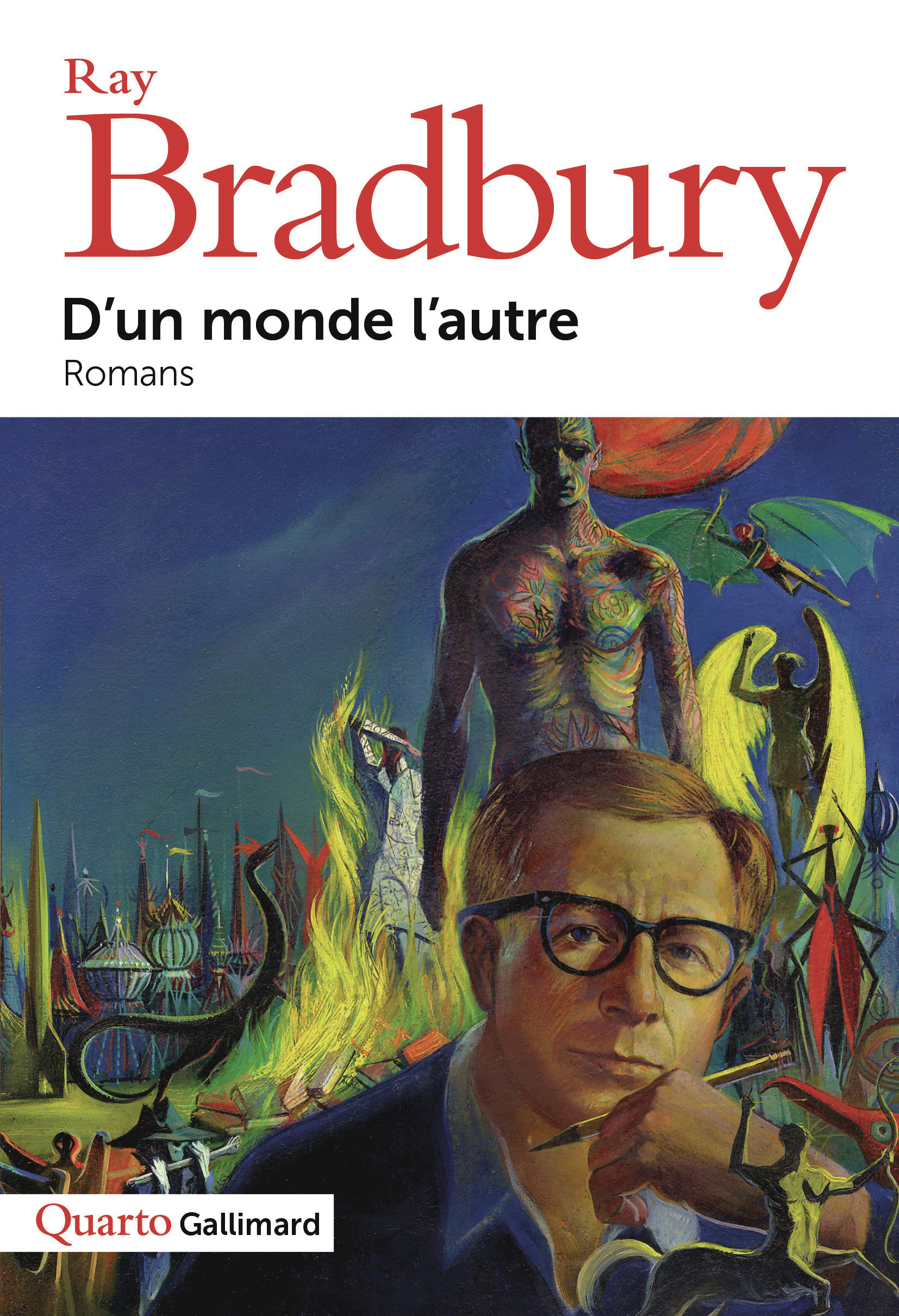
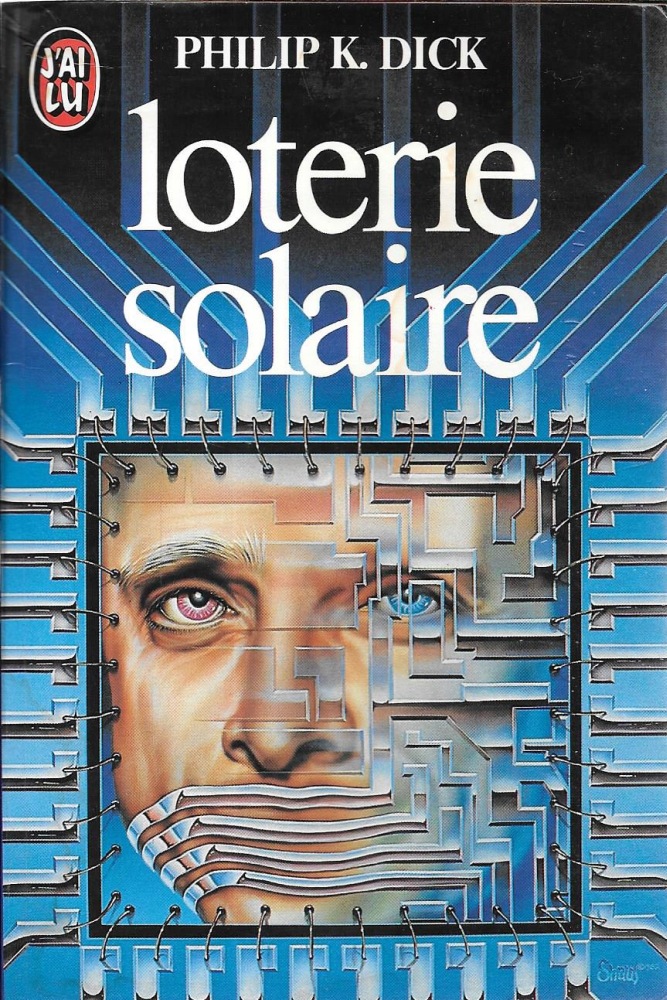
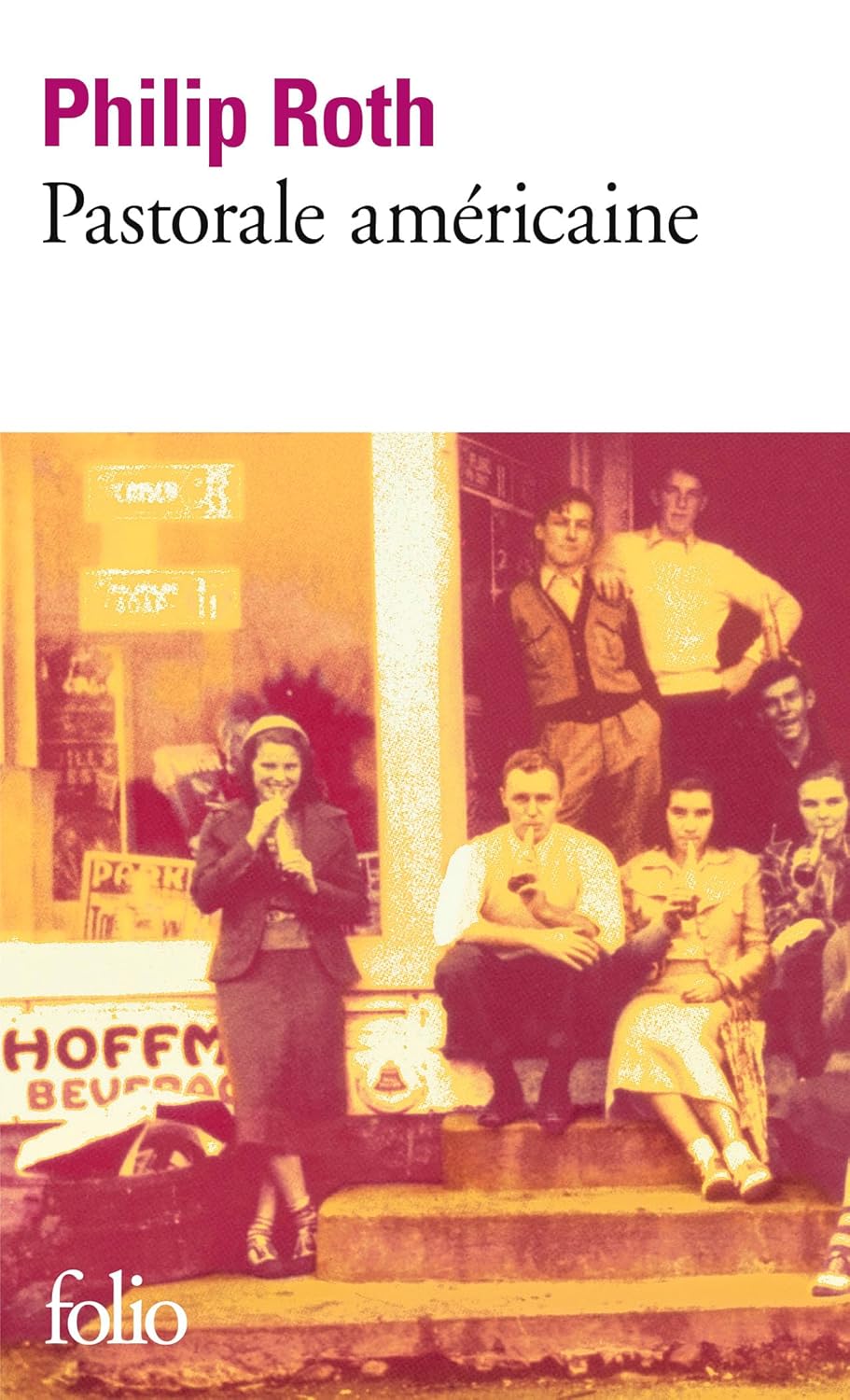
0 commentaire