Pier Maria PASINETTI: De Venise à Venise
« Annibale Tolota Pelz devait avoir, sauf erreur dans mes calculs, treize ans en 1926. C’était le benjamin de la famille. Il a toujours été aussi le plus vif et le plus volubile, tant lors de son jeune âge ici même à Venise qu’adulte plus tard dans d’autres villes d’Italie et du monde. Dernièrement on l’a revu quelquefois à Venise et l’autre soir, nous avons dîné ensemble ici, à Dorsoduro… »
A rebours de la Venise des masques et des gondoles, et de la légende littéraire d’une cité des enchantements, des dissimulations, des simulacres, il y a la Venise qu’on trouve quand on parcourt les Fondamente rectilignes de Cannaregio, qu’on se perd du côté de S.Elena, au delà des jardins de la Biennale, qu’on prend l’aperitivo sur les quais de la Giudecca, : une Venise provinciale, populaire, avec ses petites histoires de voisinage, ses amitiés qui remontent souvent aux années de collège. Ouvrir De Venise à Venise (titre original : Dorsoduro), c’est plonger pour près de 400 pages dans cette autre Venise. Il y a en effet une ville à saisir par ceux qui l’habitent et l’écheveau des relations qu’ils entretiennent entre eux. C’est ce que réussit avec brio Pasinetti. Tout l’univers de ce grand roman est donné dès la première page : un personnage, puis un autre, dont l’auteur déroule le fil de l’histoire, passant régulièrement du passé des événements racontés (une plongée dans les années 1920) au présent de la narration (les années 80).
Au début, c’est parfois un peu difficile à lire. On se perd parfois entre tous ces personnages. Mais quelque chose finit par en émerger, comme de la surface vaporeuse qu’a peint Turner à Venise. Au centre de l’histoire, une maison, le palais Bialevski et l’amitié entre trois hommes : Edoardo Bialevki, modèle du vénitien cosmopolite, libéral, cultivé, le professeur Remigio Berg, professeur d’histoire, et Alvise Balmarin, un dentiste. Dans les années où le fascisme s’impose en Italie, tous les trois ont en commun la distance polie qu’ils maintiennent à l’égard de la nouvelle idéologie. Bialevski profite de la liberté que lui donne un passeport britannique pour aider un ancien responsable politique inquiété par le nouveau régime à quitter le pays. Balmarin, promis à une brillante carrière médicale, a abandonné ses ambitions de reconnaissance sociale sur les champs de bataille du premier conflit mondial : le métier de dentiste exercé dans un modeste cabinet vénitien est une façon pour lui de se consacrer désormais à l’essentiel – adoucir la douleur des gens – tout en se maintenant à l’écart des grands mouvements de l’histoire.
Oui, mais, comme on est à Venise, plus précisément à Dorsoduro, et que chaque sestier de Venise est un tout petit monde, chacun côtoie aussi d’autres gens, avec lesquels les relations remontent souvent à l’enfance : Silvio Tolotta Pelz, qui occupe avec sa famille l’étage noble du palais Bialevski, est tout entier au sentiment de son importance, nourri de ses relations avec les autorités fascistes et les prélats de l’Eglise ; Ezio et Marcello Sbordoni, les deux beaux-frères d’Alvise Balmarin, fascistes de la première heure, cultivent pour l’un une forme de snobisme esthète à la D’Annunzio, cédant plus tard à sa fascination pour les nazis rencontrés dans l’atmosphère d’un fond de brasserie bavaroise en dirigeant une revue ouvertement antisémite, pour l’autre la nostalgie du coup de poing.
Il y a aussi les jeunes adultes, les adolescents, les enfants, sur lesquels le narrateur, qui était alors le plus jeune du groupe, offre un regard mêlé d’admiration et de nostalgie : autour des deux familles en miroir que forment les Balmarin, avec leurs deux fils, Corrado et Osvaldo, et leur fille Giovanna, et les Tolotta Pelz, avec leurs deux filles et leur fils, dont on murmure depuis l’enfance qu’ils se marieront un jour ensemble, toute un galerie de personnages anime un récit d’où émerge la belle figure de Giovanna, qui capte tous les regards.
Difficile de résumer au-delà la matière si dense, si riche de ce roman, dont j’ai à peine ici effleuré la surface. On oppose parfois l’Histoire et les histoires. En faisant résonner ensemble, parfois les uns contre les autres, les destins individuels jusqu’à produire une polyphonie magistrale, Pasinetti montre que la vraie opposition serait plutôt entre ceux qui traitent l’Histoire comme du matériel humain en gros et le respect des destinées individuelles : « Assez ! Avec les souvenirs, enough is enough, je me le disais depuis des jours. Et je me disais aussi : peut-être devrait-on s’adonner à l’Histoire solennelle et générale, avec de larges tranches d’êtres humains amalgamés, pétris tous ensemble, et qui individuellement demeurent inexplorés, inexistants. Partir de l’idée que chaque individu constitue un univers, c’est comme vouloir mesurer l’infini. » Tout l’humanisme de l’auteur est finalement de ne pas avoir renoncé à se confronter à cet infini.
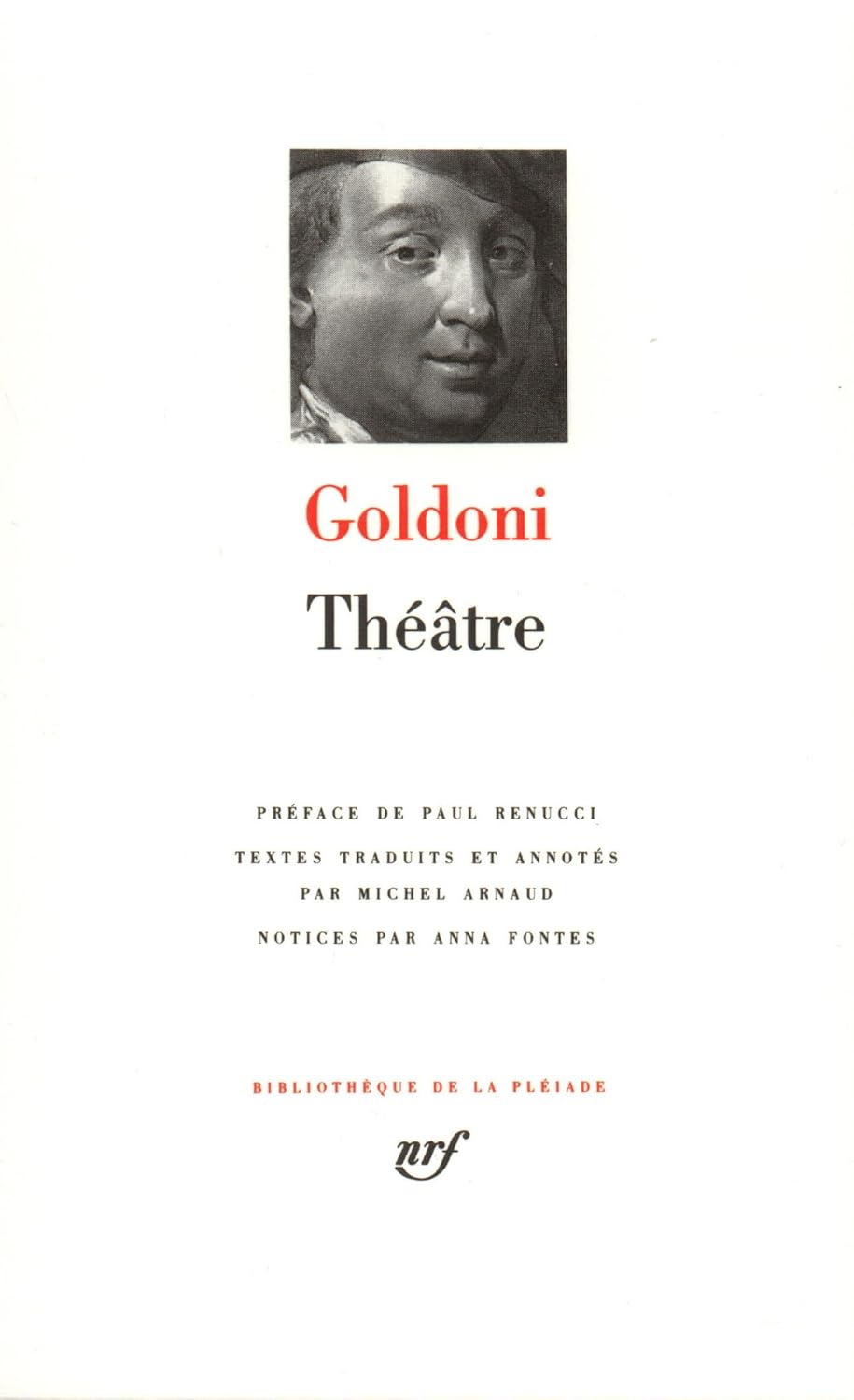
0 commentaire